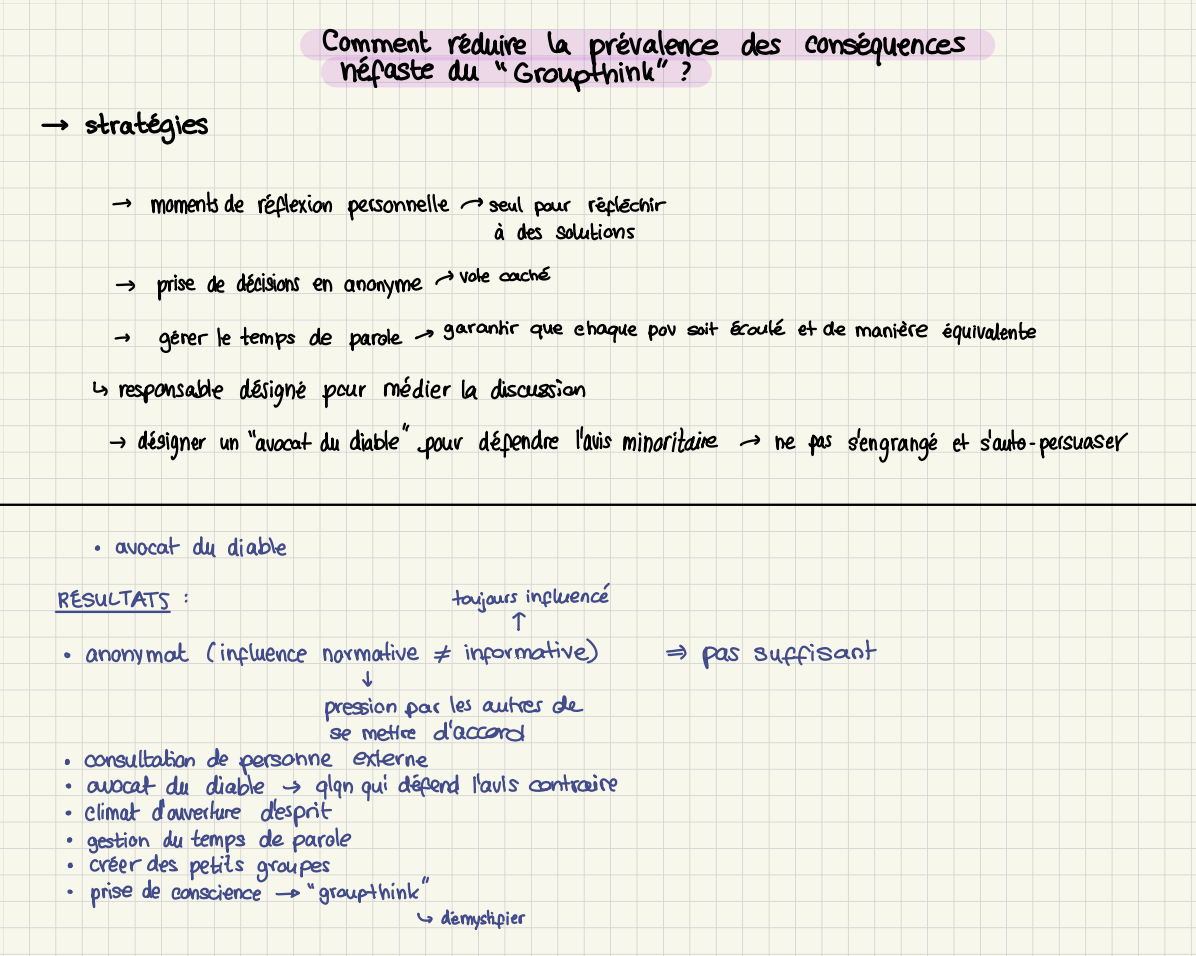chapitre 6 - conformisme & obéissance
1/33
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
34 Terms
Le conformisme de Solomon Asch (1907-1996)
influence normative et influence informative (Asch)
“groupthink” (Janis)
un changement de comportement ou de croyance à partir d’une pression implicite de groupe, adoption du point de vue majoritaire
majorité quantitative
→ détient son pouvoir du nombre même de ses adhérents
“quantité” → majorité à être majoritaire
majorité qualitative
→ détient son pouvoir de la compétence, son prestige, son autorité, légitime ou non
“qualité” → minoritaire à être majoritaire
→ conformité avec des normes (majoritaires) préexistantes
L’effet Asch (1951)
→ étude très importante pour la discipline
hypothèse
l’individu émet un jugement contraire au bon sens lorsque la pression (implicite) du groupe est suffisamment élevée
situation expérimentale
sept sujets réunis autour d’une table (un sujet naïf et six comparses)
jugements perceptifs « publics »
résultats
37% de réponses conformistes (en absence de pressions explicites)
nombreuses réplications de l’effet
→ un tiers des gens prêt à se conformer pour ne pas dévier de la position majoritaire
⇒ Pouvoir de la majorité
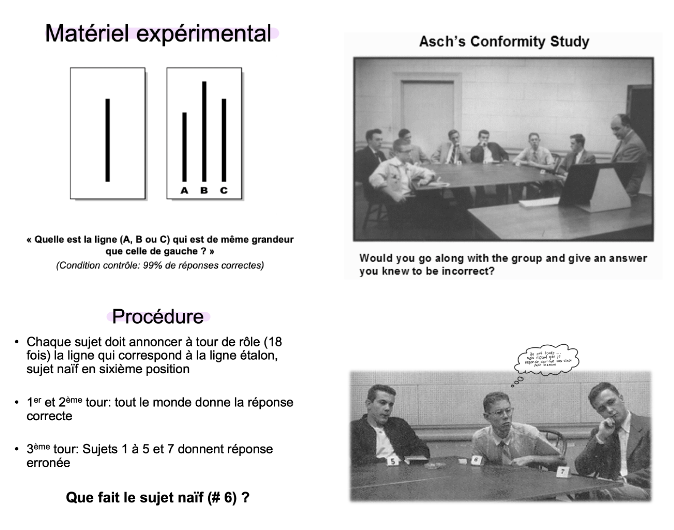
Variations de l’effet Asch
Deux sujets naïfs dans un groupe de 8 (placés en position 4 et 8) (Asch, 1955) à
→ taux de conformisme : 10%
un sujet naïf et un compère donnant la réponse correcte (Asch, 1955)
→ taux de conformisme: 5%
sujet naïf et compère avec lunettes épaisses donnant réponses correctes (Allen & Wilder, 1971) → le contexte ayant changé, ce changement pourrait être expliqué en partie par un changement de normes sociales : “c’est acceptable d’être différent”
→ taux de conformisme négligeable
Explications du conformisme
influence normative
influence informative
Influence normative
motivation à se faire accepter, apprécier par le groupe. Suivisme de la norme du groupe, juste ou fausse, comme signe de loyauté
motivation à éviter la déviance, la différence. Celle-ci peut entraîner le rejet, la marginalisation, ou la sanction
→ conformisme = Stratégie de reconnaissance
Influence informative
l’influence majoritaire génère de l’incertitude quant à la validité de ses opinions
l’incertitude est désagréable, reflète un conflit intérieur
donc: validation sociale par la comparaison de ses opinions
→ conformisme = stratégie de réduction de l’incertitude
Résistance au conformisme
• un animité de la majorité comme facteur essentiel du conformisme
lorsqu’une personne reçoit du support social, elle est plus à même de manifester ses vraies opinions, attitudes, croyances, et de résister à l’influence de la majorité
le support social peut être :
une personne qui a la même opinion
une personne qui n’est pas d’accord avec la majorité
→ amène à la résistance
Les « indépendants »
ont confiance en leur propre perception
manifestent un retrait psychologique par rapport à la situation et à la pression du groupe
se caractérisent par un doute qu’emporte finalement leur propre jugement
→ c’est une description situationnelle, et non pas une explication personnologique !
Les « conformistes »
se soumettent à la majorité de peur des conséquences que pourrait entraîner la désobéissance
suivent la majorité parce que son unanimité plaide en faveur de son exactitude
→ c’est une description situationnelle, et non pas une explication personnologique !
Bilan des études de Asch
les études d’Asch sont pertinentes autant pour l’analyse du conformisme que de la résistance et de la rébellion
une minorité s’est conformée, une majorité a résisté
il faut tenir compte simultanément des dynamiques de dépendance et d’indépendance qui ont chacune leurs dynamiques et motivations particulières
« Groupthink » (Janis, 1971)
une forme de pensée collective qui néglige l’existence d’alternatives
suppression de toute différence d’opinion dans un groupe qui doit prendre une décision
s’applique notamment aux groupes puissants, aux « experts »
“echo chamber”
→ une seule vision des choses
on ne sait pas qu’une autre réalité existe
Formation du groupthink
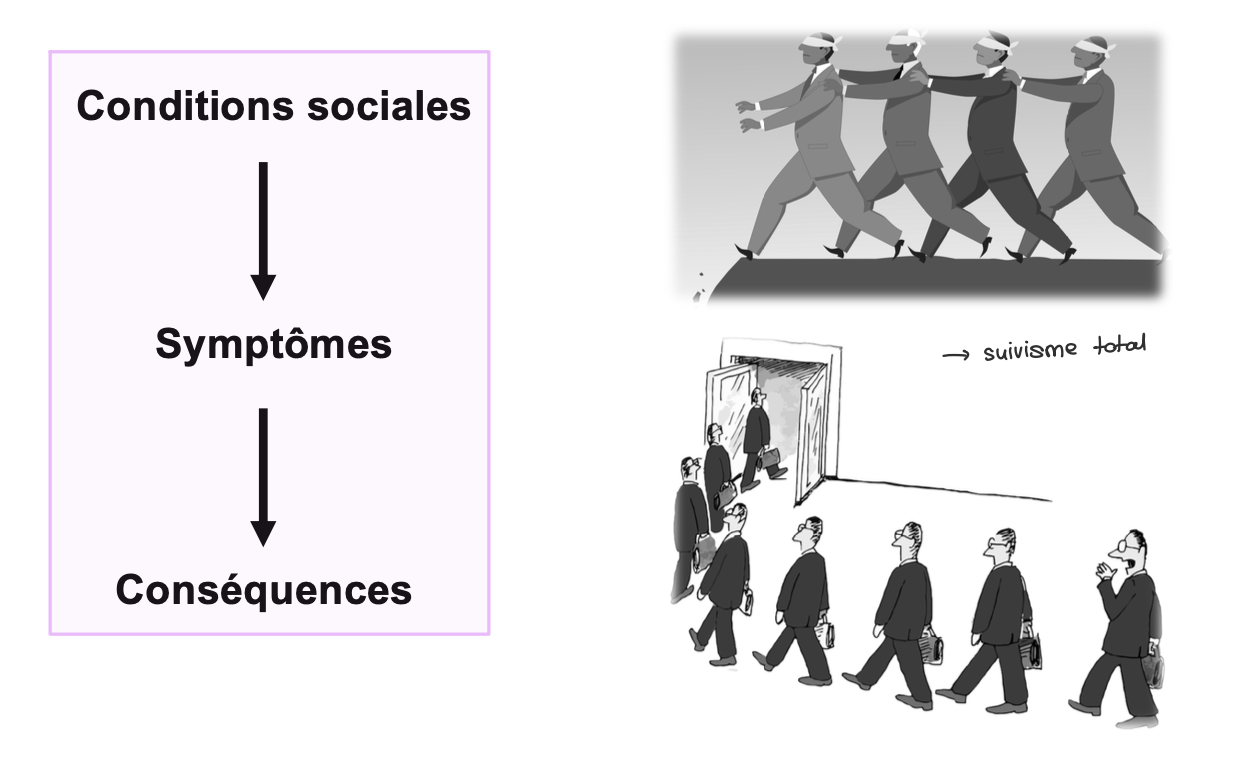
Conditions d’émergence du groupthink
risques :
niveau de stress élevé
→ décisions importantes
un leader puissant
cohésion élevée du groupe
→ groupe isolé de points de vues contraires
manque de procédures de prise de décision
→ qui donnent une place aux idées alternatives
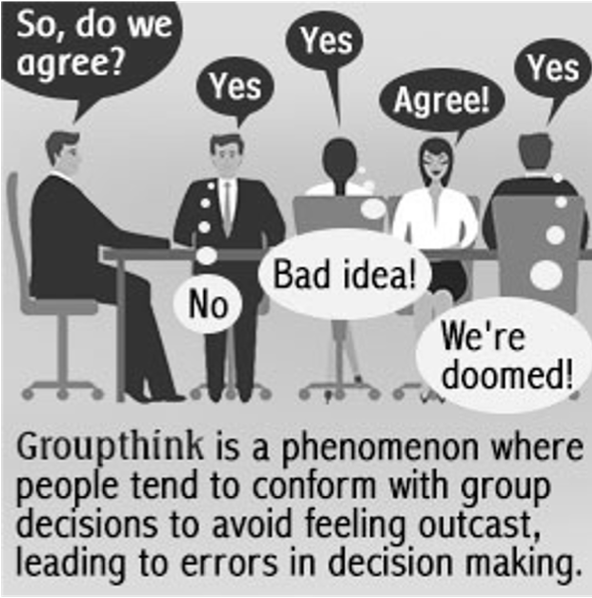
Symptômes (Janis, 1977) – groupthink
illusion d’invulnérabilité, optimisme excessif
→ convaincu par notre décision
surestimation de la moralité et du pouvoir du groupe
rationalisation, justification des décisions
illusion d’unanimité
pression au conformisme, ridiculisation de membres non-conformes
image stéréotypée du groupe adversaire
Conséquences – groupthink
décisions collectives erronées
manque de considération d’alternatives
manque d’évaluation des risques
manque de recherche d’informations
traitement de l’information sélectif
Exemple de groupthink - Poutine et les symptômes du groupthink dans l’invasion de l’Ukraine
illusion d’invulnérabilité, optimisme excessif
attentes de succès militaire irréalistes
→ pensait avoir du succès rapidement
sous-estimation des réactions occidentales
surestimation de la moralité du groupe
«Mission historique pour rétablir la grandeur de la Russie»
taille
importance / puissance
rationalisation, justification des décisions (après coup)
«Libérer l’Ukraine des Nazis et des drogués»
«Se défendre contre la menace occidentale»
illusion d’unanimité
opinions alternatives dangereuses
→ les personnes pas d'accord ne s'exprime pas par peur des répercutions
pression au conformisme , ridiculisation de membres non-conformes
ridiculisation et humiliation publique d’opinions contraires
image stéréotypée du groupe adversaire
intergroupe : Ukrainiens menaçants, violents, agressifs
intragroupe : Traîtres russes, dissidents, exilés en Occident
Discussion du conformisme et du groupthink
dans les sociétés occidentales, le conformisme a une connotation « péjorative », mais :
on peut se faire influencer parce qu’on est convaincu (sans conscience d’avoir tort)
l’uniformité d’un groupe peut être bénéfique (efficacité, force du groupe)
→ prise de décision
IMPORTANT :
le «groupthink« ne doit pas servir à déresponsabiliser les membres du groupe
ceux-ci maintiennent un pouvoir décisionnaire important pour atteindre un objectif précis, et restent donc responsables de leurs actes
→ responsabilité individuelle
conformisme ⇒ efficacité
L’obéissance de Stanley Milgram
→ soumission à l’autorité
l’obéissance comme réponse à une tentative d’influence de la part d’une source investie d’autorité
rapport de pouvoir entre subordonné et autorité : pression explicite à la conformité
Milgram (1961 / 1974) : apprentissage et chocs électriques
tentative d’explication des mécanismes psychologiques ayant rendu possible l’holocauste
les principes de base de nos sociétés s’opposent (généralement) à la torture
le paradigme expérimental de Milgram demande aux sujets de torturer autrui
le paradigme précise les conditions sociales qui amènent les gens à torturer autrui
→ donc le contexte et pas les conditions psychologiques d’un individu
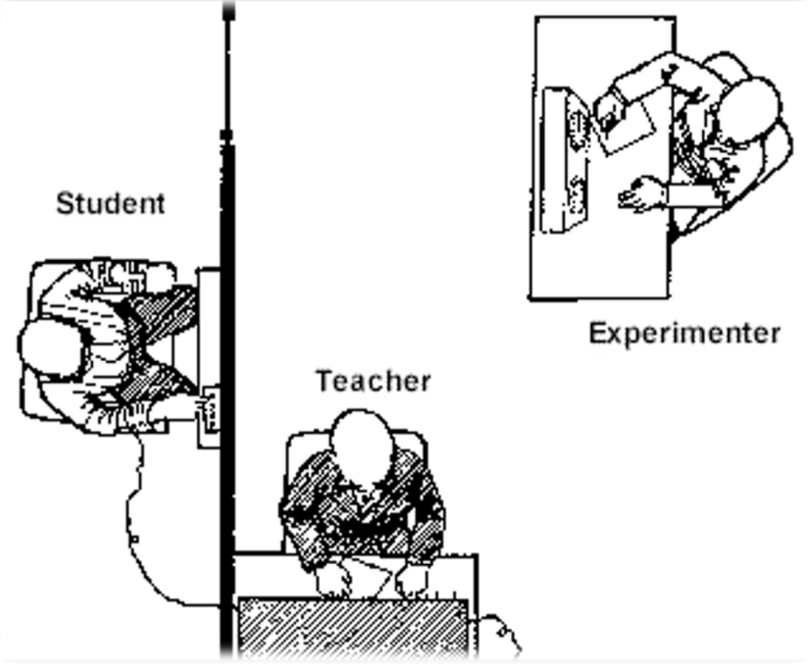
Procédure – apprentissage et chocs électriques
un vrai participant (« l’enseignant ») doit faire mémoriser une liste de paires de mots à un « élève » (en réalité un compère)
chaque erreur, il doit donner à « l’élève » un choc électrique (en réalité il n’y a pas de courant)
chaque choc est d’intensité croissante, de 15 V à 450 V
suivant les conditions, «l’enseignant » entend, voit ou touche sa victime
fois que « l’enseignant » (le participant) hésite ou veut arrêter, l’expérimentateur (l’autorité scientifique en blouse grise) dit au participant
‘Please continue’, ‘please go on’
‘The experiment requires that you continue’
‘It is absolutely essential that you continue’
‘You have no other choice, you must go on
→ 1-3 : incitation explicite
→ 4 : ordre explicite
l’élève commence à crier, et à 150 V dit qu’il veut arrêter. A 300 V il ne réagit plus, comme s’il était mort
Principe du paradigme expérimental – apprentissage et chocs électriques
amener des gens tout-venant à administrer des chocs électriques à un « innocent » au nom d’une autorité (scientifique)
questions:
combien de personnes vont jusqu’à donner les chocs maximaux (mortels) de 450 volts?
quelles sont les conditions qui permettent de rompre l’obéissance à l’autorité ?
→ variations dans le degré d’obéissance
Différentes conditions de l’expérience – apprentissage et chocs électriques
Condition « Contrôle » (sans autorité)
choc moyen maximal : 90 V
1 participant sur 40 (2.5%) va jusqu’à 450V
Condition « Autorité scientifique »
62.5% des participants dans l’expérience de base (avec feedback vocal) vont jusqu’à infliger des charges électriques mortelles (450V)
la moyenne du choc maximal s’élève à 360V
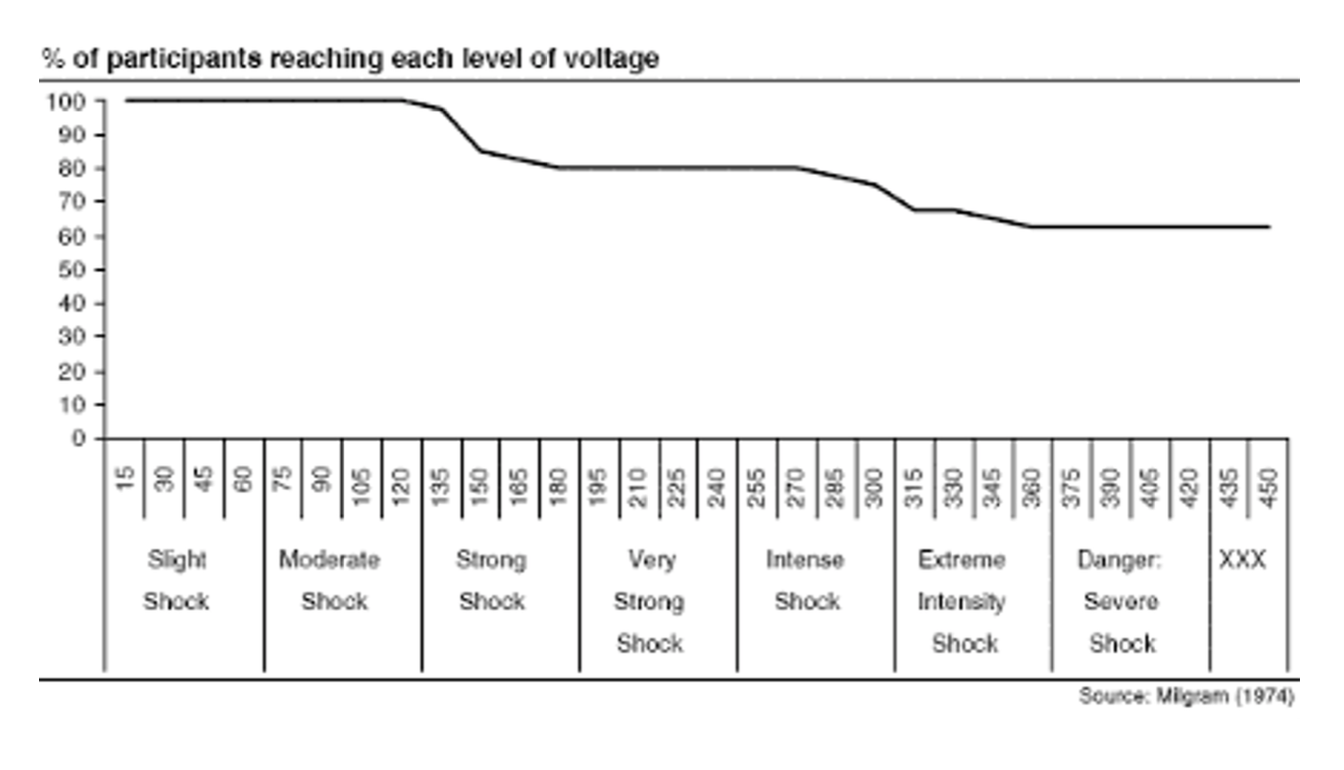
Explication (initiale) – apprentissage et chocs électriques
l’autorité est considérée comme le garant et le responsable moral de la tâche (et des implications de la tâche)
→ passage d’un état « autonome » à un état « agentique »
l’autorité déresponsabilise le participant qui devient l’exécutant de l’autorité
marionnette
→ les participants s’occupent uniquement de suivre la procédure définie par l’expert / l’autorité
Variations de l’effet Milgram
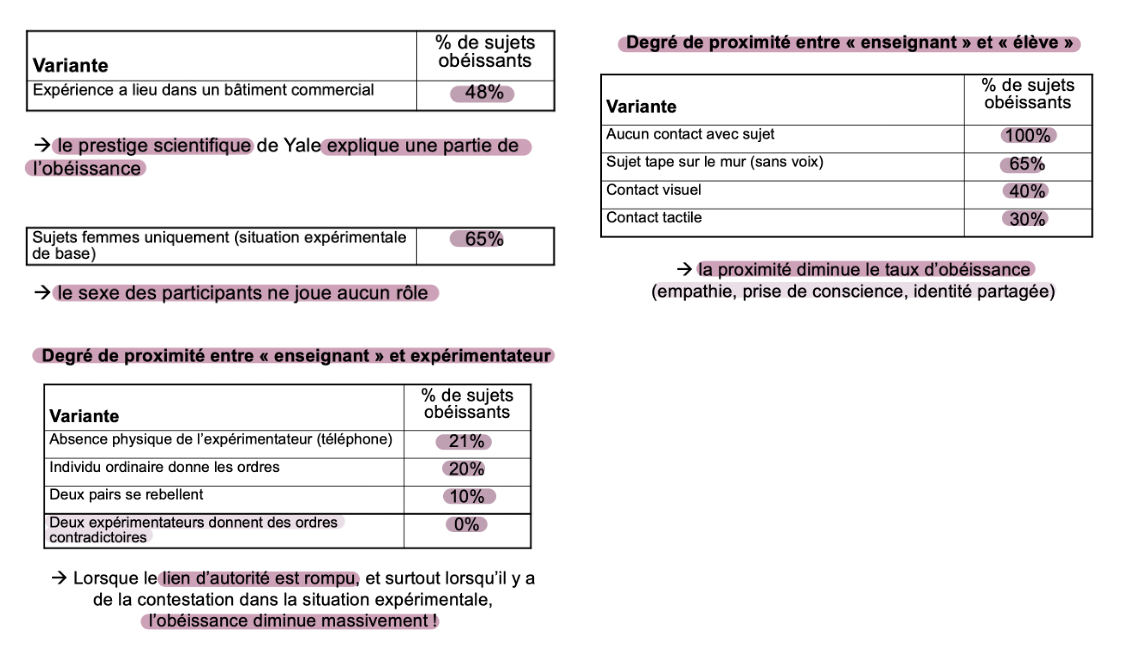
L’importance de la situation : Facteurs favorisant la soumission
contexte pseudo-scientifique de l’étude
prestige associé à la collaboration scientifique (Yale)
le statut de l’expérimentateur (supérieur au sujet et à la victime)
ambiguïté par rapport à l’importance scientifique de l’expérience
situation expérimentale
consistance des ordres de l’expérimentateur
inconsistance de la victime (accepte, puis refuse)
assurance qu’il n’y aura pas de dommages persistants
ambiguïté des indications du voltage («XXX»)
conditions psychologiques
engagement successif dans des chocs de plus en plus forts (engrenage)
isolement social du sujet, absence de critères de jugement
Obéissance et identité partagée
l’obéissance chez Milgram dépend d’une identité partagée avec l’autorité : le participant obéissant se voit comme étant « plus proche » de l’expérimentateur que du sujet
les participants obéissent en raison de leurs convictions !
IMPORTANT : Aucun participant continue après la quatrième injonction (‘You have no other choice, you must go on’)
→ ironie de l’expérience: Quand l’injonction de l’expérimentateur est présentée comme un ordre, le rapport d’obéissance est rompu !
Obéissance administrative
réplique l’effet Milgram avec un autre paradigme expérimental
→ violence administrative, souffrance psychologique plutôt que physique
image stéréotypée de la victime
→ chômeurs
Procédure – Obéissance administrative
les sujets sont des recruteurs devant passer un test psychologique à des chômeurs à la recherche d’un emploi (compère)
→ complice = au courant de l’expérience, se comporte de manière attendue
prétexte: étude sur lien entre stress et performance
les candidats (compères) répondent à un test dont la réussite serait indispensable pour obtenir l’emploi
l’expérimentateur demande aux sujets de faire des remarques désobligeantes au candidat (jusqu’à 15) afin de pouvoir évaluer sa capacité à faire face au stress
le candidat stresse, proteste, mais échoue de plus en plus à la tâche
les sujets pensent donc avoir le pouvoir de faire échouer le candidat, le laissant sans post
Résultats – Obéissance administrative
91.7% des sujets vont jusqu’au bout de la violence psychologique (utilisation moyenne des remarques : 14.81)
les sujets, en tant qu’agents de l’expérimentateur, ont agi de façon désobligeante et distante à l’égard du candidat
→ niveau d’obéissance même plus élevé que chez Milgram
→ plus facile à obéir un ordre demandant d’infliger de la violence administrative plutôt que physique
Variations expérimentales – Obéissance administrative
indication explicite que le sujet peut arrêter quand il veut
sujets travaillant dans les RH
avertissement préalable (condition « Lettre ») du déroulement expérimental et des implications « morales »
→ pas de changement notable
M & R: « Qualité des relations sociales envers des personnes neutres dans notre société ; les ordres de l’autorité l’emportent sur le lien personnel et la solidarité avec les chômeurs ; l’autorité décide »
Obéissance et responsabilité juridique
Sujets avertis oralement que le candidat peut engager une procédure judiciaire contre l’université.
→ Le sujet doit signer un document selon lequel il est seul responsable.
40% refusent
30% s’arrêtent au milieu
30% vont jusqu’au bout
Avertissement préalable (condition « Lettre ») de responsabilité juridique
80% de refus
Conclusion obéissance
lorsque les participants se sentent personnellement responsables des souffrances infligées, l’obéissance diminue
→ évitement de risque
→ la responsabilité juridique « casse » le pouvoir de l’autorité
→ la responsabilité juridique rend les individus autonomes
Le pouvoir de la situation
pour Milgram, les comportements inhumains sont le produit de situations plutôt que de personnes malveillantes
le dilemme : compte tenu du pouvoir de la situation sur les conduites humaines, quelle est la place de la responsabilité, de l’autonomie et de la liberté individuelle ?
explication personnelle
→ une personne méchante
contexte expliquant le comportement
Comment réduire la prévalence des conséquences néfaste du “groupthink” ?