TD9- La fondamentalisation du droit constitutionnel
1/33
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
34 Terms
TD9- La fondamentalisation du droit constitutionnel
I. Trois générations de droits fondamentaux
II. Consacrer les droits fondamentaux
A. Au niveau national
B. Au niveau européen
C. Au niveau international
III. Garantir les droits
A. Le contrôle de constitutionnalité
B. Le contrôle de conventionnalité
C. Le référé-liberté
I. TROIS GÉNÉRATIONS DE DROITS FONDAMENTAUX
C’est quoi un droit ?
Droit ≃ liberté
Il y a deux grands types de libertés :
La liberté politique : le droit des citoyens de désigner leurs gouvernants ;
Les libertés individuelles.
L’émergence des libertés individuelles est une réalité individualiste.
Les droits et libertés individuelles vont être ceux qui « permettent aux personnes de réaliser, avec indépendance et efficacité, leur destinée particulière » (Jean-Éric Gicquel). Il s’agit d’un « pouvoir d’autodétermination » (Jean Rivéro)
DDHC art. 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression »
Il existe donc quand même des droits fondamentaux avant 1958.
3 générations de droits fondamentaux
Droits de première génération : « droits- libertés », droits civils et politiques.
Droits de deuxième génération : « droits créances », droits économiques et sociaux.
Droits de troisième génération : « droits collectifs/internationalistes » : environnement sain, numérique, animaux, droits des générations futures, droits d’ingérence humanitaire...
C’est Karel Vasak, conseiller juridique à l’UNESCO, qui a inventé cette distinction.
II. CONSACRER LES DROITS FONDAMENTAUX
De la nécessité de consacrer les droits dans des déclarations
Une réalité ancienne, initiée en Angleterre :
Magna Carta du 12 juin 1215 ;
Petition of Rights du 7 juin 1628 ;
Bill of Rights du 13 février 1689
=> actes concrets, avancées concrètes dans le sens d’une plus grande liberté politique et, dans une moindre mesure, de plus grandes libertés individuelles
Tout ne commence pas non plus donc avec la DDHC.
La naissance des déclarations des droits :
Véritable naissance dans les États fédérés de l’Amérique du Nord lorsqu’ils proclament leur indépendance, la plus célèbre étant celle de Virginie du 12 juin 1776.
Puis, vraiment la DDHC le 26 août 1789 ⭢ aspect universel, humaniste, et à la fois très individualiste ;
Universel pcq cherche à déclarer des droits universels de l’Homme, pas que du citoyen français
Adaptabilité des déclarations des droits : en France, aucune déclaration des droits en 1875. Un régime pourtant particulièrement libéral, père de grandes lois sur les libertés publiques ;
Diffusion du mouvement : une affirmation solennelle des droits fondamentaux qui déborde largement le cadre national.
= fondamentalisation du droit
A. AU NIVEAU NATIONAL
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
La Déclaration de 1789
Adoptée par l’Assemblée constituante le 26 août 1789.
Déclaration des droits associée à la Constitution du 3 septembre 1791.
Disparaît ensuite des textes constitutionnels jusqu’à la IVème République auquel le Préambule fait référence.
Pour autant, elle n’avait pas perdu toute valeur juridique.
Dans ses conclusions sur l’arrêt CE, 1917, Baldy, le commissaire du Gouvernement Corneille déclarait qu’elle est « implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines ».
Quelques droits consacrés : égalité des citoyens, liberté individuelle, liberté d’opinion, liberté de communication, propriété privée, règles fondamentales du droit pénal (proportionnalité, non rétroactivité)...
Le préambule de la Constitution de 1946
Préambule consacre 2 grands types de droits
Alinéa 1 : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». L’expression cherche à « constitutionnaliser » les grandes libertés de la IIIème République : liberté de réunion (loi du 30 juin 1881), liberté syndicale (loi du 21 mars 1884), liberté d’association (loi du 1er juillet 1901), séparation des Églises et de l’État (loi du 9 décembre 1905).
⭢ Le constituant voulait que cette expression renvoie aux grandes lois de la IIIe République (cf les travaux préparatoires).
Alinéa 2 : « principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps », clairement énumérés : égalité des femmes et des hommes, droit d’asile, droit de grève, droit à la santé, à l’éducation, aux loisirs, à la solidarité...
⭢ Les droits de deuxième génération (mais pas que).
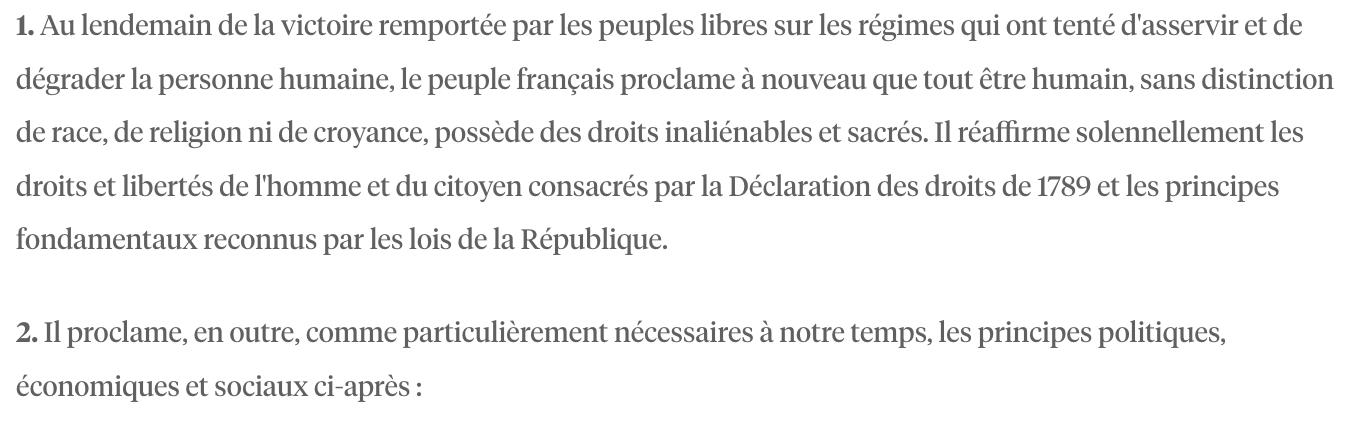
La Charte de l’environnement de 2004
Ajout de cet élément dans le Préambule par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
Principes consacrés : prévention, réparation des dommages causés à l’environnement, principe de précaution...
Le Conseil constitutionnel a confirmé après que la Charte de l’environnement était en effet constitutionnalisée par son entrée dans le préambule de la Constitution. Cela n’allait pas de soi puisqu’elle n’a pas la même légitimité ⭢ c’est un référendum au suffrage universel direct qui a validé la présence des autres textes dans le préambule.
La Constitution du 4 octobre 1958 et la protection des droits fondamentaux
La Constitution détermine bien la forme du Gouvernement et les règles essentielles de son fonctionnement, et protège les droits fondamentaux… mais plutôt de façon contingente.
CC, DC, 1971 (16 juillet), Liberté d’association :
Une loi prévoyait de soumettre à validation les créations d’association.
Le président du Sénat saisit le Conseil constitutionnel en affirmant que la loi est incompatible avec la liberté d’association protégée par la DDHC.
Le Conseil constitutionnel décide que si le préambule de la constitution fait référence à des textes, c’est parce que le constituant voulait qu’ils en fassent partie.
Dans un “considérant”, il répond “vu la Constitution et notamment son préambule”. Il a donc élargi ses normes de référence de contrôle : c’est la naissance du bloc de constitutionnalité (expression de Louis Favoreu).
Le Conseil constitutionnel se donne le rôle de protection des droits fondamentaux au travers de la DDHC et du préambule de la Constitution de 1946 avec son expression de “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” (PFRLR) et qui fait référence à plusieurs lois ordinaires d’avant 1946.

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs consacré explicitement la pleine valeur juridique
En 1971 le CC dit “vu la Constitution et notamment son préambule” ⭢ il ne dit pas explicitement que tous les textes qui en font partie ont valeur constitutionnelle.
DDHC : CC, DC, 1973, Taxation d’office
Préambule 1946 : CC, DC, 1994, Lois du bioéthique
Charte de l’environnement : CC, DC, 2008, Loi relative aux OGM
Par ailleurs, la Constitution elle-même consacre également des droits
L’article 4 de la Constitution consacre le pluralisme.
L’article 34 de la Constitution indique qu’il revient à la loi de fixer les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques »
⭢ Consécration constitutionnelle des libertés publiques.
L’article 66 de la Constitution constitutionnalise la liberté individuelle : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, veille au respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
L’article 72 de la Constitution consacre la libre administration des collectivités territoriales.
B. AU NIVEAU EUROPÉEN
Point de définition : le droit européen
Par droit européen, on entend deux choses :
Le droit de l’Union européenne (parfois, le droit communautaire, on peut dire les deux) dépasse le cadre du droit international (même s’il en fait partie) puisqu’il s’agit d’ « imposer » un nouvel ordre juridique aux États membres, de former un échelon supérieur à celui des États. Produit des normes (règlements, directives).
Le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme (attention, c’est le Conseil de l’Europe et pas l’Union européenne), c’est un droit international public centré sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CEDH = Cour européenne des droits de l’homme.
Conv. EDH ou CESDLF = Convention européenne des droits de l’homme.
Le Conseil de l’Europe et la CESDHLF
Le Conseil de l’Europe est institué en 1949, il regroupe 47 États.
Son objectif est d’assurer la prééminence des droits fondamentaux (leur raison d’existence).
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) signée à Rome le 4 novembre 1950.
Des droits inconditionnels (droit à la vie, interdiction des traitements inhumaines ou dégradants, de l’esclavage, du travail forcé) et des droits conditionnels (droits civils et politiques, libertés individuelles, droits économiques et sociaux...).
Droits conditionnels ⭢ s’agit de s’assurer que les atteintes sont proportionnées.
L’Union européenne et la Charte européenne des droits fondamentaux
Centrée au départ sur les questions douanières et commerciales, l’Union européenne ne se préoccupait pas vraiment des droits fondamentaux.
La consécration de droits fondamentaux est d’abord partie du juge qui s’est mis à consacrer des principes généraux du droit de l’Union européenne : l’Etat de droit, le principe de sécurité juridique, le principe de non-discrimination, le droit à un procès équitable, l’interdiction de la double sanction, la non-rétroactivité des dispositions pénales, le principe de solidarité entre les Etats membres...
À partir du traité de Maastricht, intégration du respect des droits fondamentaux dans les traités.
En 2000, adoption d’une Charte des droits fondamentaux qui reçoit du traité de Lisbonne pleine valeur de traités.
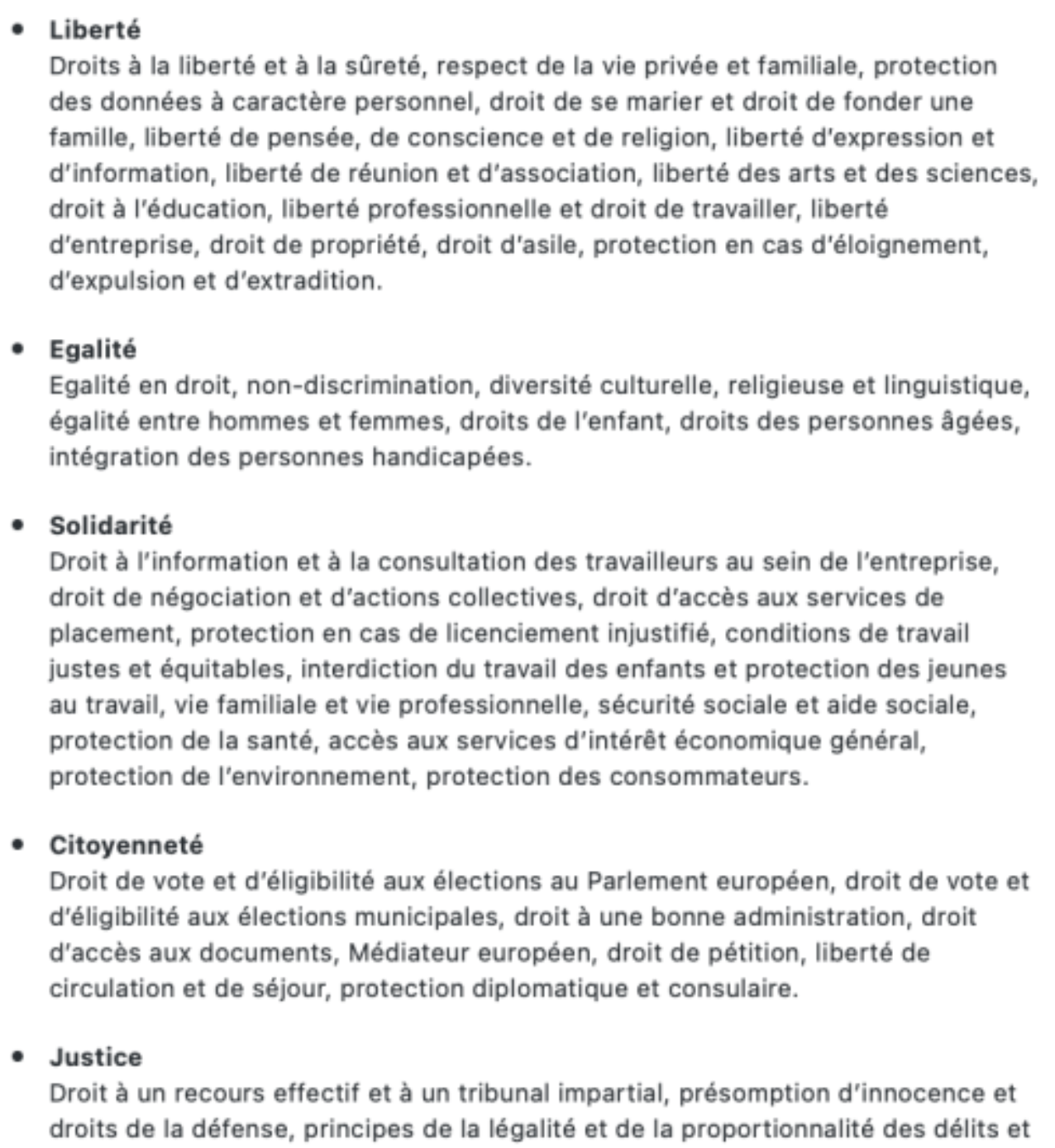
C. AU NIVEAU INTERNATIONAL
Un droit international qui s’est de plus en plus intéressé aux droits et libertés
On a une subjectivisation du droit ⭢ progressivement, le droit international s’intéresse à l’individu, avant il ne s’intéressait qu’aux Etats (souveraineté…).
Actes déclaratifs sans portée contraignante : Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ;
Puis, conventions internationales, à portée contraignante :
Convention de Genève sur les réfugiés et apatrides de 1951 ;
Pacte des Nations Unies de 1966 sur les droits civils et politiques ;
Pacte des Nations Unies de 1966 sur les droits économiques et sociaux ;
Accord de Paris sur le climat en 2015
...
III. GARANTIR LES DROITS
L’insuffisance d’une consécration et la nécessité d’une garantie
L’idée est que la Constitution ne suffit pas, il faut qu’elle soit garantie par un juge.
« Si la Constitution est une norme supérieure à la loi, cette suprématie doit être garantie » (Michel Troper).
Principe de base de la pensée de Hans Kelsen notamment dans son ouvrage, La garantie juridictionnelle de la Constitution (1928).
A. LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Du contrôle de constitutionnalité des textes réglementaires au contrôle de constitutionnalité des lois
Avant 1958, pas de contrôle de constitutionnalité des lois. Mais déjà une application des principes constitutionnels par le Conseil d’État vis-à-vis des règlements :
CE, 1950 Dehaene : par rapport au droit de grève
CE, 1956 Amicale des Annamites de Paris : par rapport à la liberté d’association.
==> Le CE applique déjà les PFRLR.
À partir de 1958, le Conseil constitutionnel commence un contrôle de constitutionnalité (surtout vis-à-vis du respect des domaines de la loi et du règlement). Dès 1971, il opère un contrôle qui garantit les droits et libertés.
Avec la mise en place de la QPC lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, renforcement de la protection des droits fondamentaux.
Parce que la QPC est justement centrée sur les droits et libertés (on ne peut pas poser une QPC sur la base d’un problème de procédure par exemple).
Et en plus c’est a posteriori.
Les principes dégagés par le CC, outil de garantie des droits
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) qui, selon une décision DC, 1988, Lois d’amnistie doivent répondre à trois critères (avant il faisait un peu comme il voulait) :
Être tirés d’une législation républicaine (mais y en a un tiré de la monarchie républicaine en 1790…) ;
D’une législation datant d’avant l’entrée en vigueur du préambule de 1946 (parce que sinon c’était pas la volonté du constituant de 1946) ;
Constance et répétition hors Vichy.
==> Ce sont les critères obligatoires, mais ils ne sont pas les seuls. Le Conseil constitutionnel applique aussi des critères de substance et en fonction du degré d’importance.
Exemples : liberté d’association (1971), indépendance des professeurs d’université (1984)
Les principes à valeur constitutionnelle, plus éloignés de la lettre même de la Constitution, non écrit ou à dimension purement symbolique a priori ⭢ le CC se fonde sur des articles de la Constitution et en tire des principes qui ne sont pas formellement écrits.
Exemples : continuité du service public (art.5) (1979), principe de fraternité (2018)
Les objectifs à valeur constitutionnelle, idée de conciliation à opérer, idée que permet de justifier des atteintes à un principe ⭢ le CC lance un appel à la conciliation, il s’agit d’objectifs mais qui ne priment pas.
Exemples : sauvegarde de l’ordre public (1982), protection de l’environnement (2020).
Les étapes de la QPC
1/ La QPC peut être soulevée devant toute juridiction.
Sauf les cours d’assise puisque le peuple est présent avec le juré.
2/ La juridiction du fond regarde alors le caractère sérieux ou non de la question.
Le juge du fond doit se prononcer « sans délai » et choisit ou non de transmettre au ⭣.
Le procès est arrêté si la QPC passe.
3/ Le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation a trois mois pour décider de saisir ou non le CC. Iel le fait si trois conditions sont réunies :
La disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
La disposition législative critiquée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4/ Le CC a trois mois pour se prononcer.

La réussite de la QPC
Entre la mise en application du dispositif et le 30 juin 2025, 1029 décisions ont été rendues, soit une moyenne de 65 décisions par an, avec un pic de 110 décisions QPC en 2011.
« La Constitution est désormais l’affaire du citoyen » (Jean-Louis Debré)
Entrée de la France dans la « majorité constitutionnelle » (Guy Carcassonne)
B. LE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ
ATTENTION
Ne pas confondre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux !
Le Conseil constitutionnel exerce bien le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux
En cas de clause contraire à la Constitution, le traité ne peut être adopté qu’en cas de révision de la Constitution.
Si le Conseil constitutionnel déclare donc qu’un traité ou accord international comporte une ou plusieurs clauses contraires, il faut procéder à une révision de la Constitution pour ratifier l’accord.
Le Conseil constitutionnel doit inviter à la révision.
Ce fût le cas avant de ratifier les grands traités européens.
Mais on peut également refuser de le faire, ce fut le cas pour la Charte européennes des langues régionales et minoritaires (1999) pcq art.2 dit que langue est le français.

L’article 55 impose de réaliser un contrôle de conventionnalité des lois
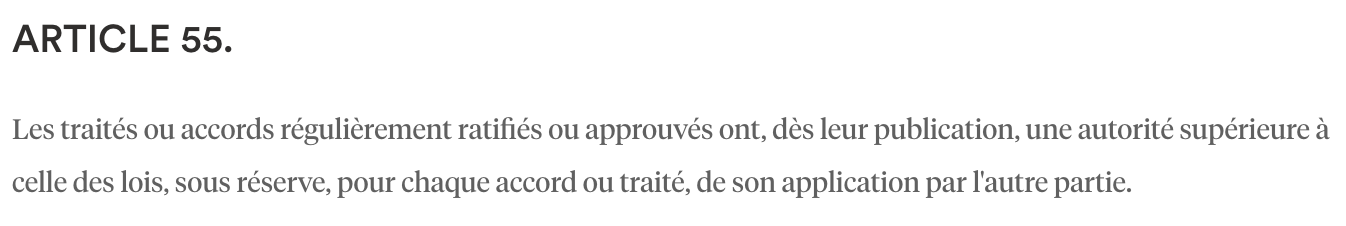
C’est un contrôle du respect des lois vis-à-vis des traités (pyramide des normes), mais quel juge sanctionne ?
Le Conseil constitutionnel ?
CC, DC, 1975, « IVG » : des députés saisissent le CC en disant que la loi IVG serait contraire à la Conv. EDH qui proclame un droit à la vie.
Le CC s’est déclaré incompétent pour opérer un contrôle général de conventionnalité.
Il renvoie au Conseil d’État et à la Cour de cassation (plus largement à l’ensemble des juridictions ordinaires) le soin d’opérer ce contrôle.
La Cour de Cassation ?
Cass, 1975, Société des cafés Jacques Vabre : Accepte, dit que les juges judiciaires doivent systématiquement faire un contrôle de conventionnalité dans les procès.
Le Conseil d’Etat ?
Au début le CE refuse :
Il est légicentriste, il n’aime pas le fait que les traités soient au-dessus des lois dans la pyramide des normes ;
S’il acceptait, son rôle serait d’opérer un contrôle des décrets vis-à-vis des traités, or entre les deux il y a la loi et les décrets dépendent souvent de la loi donc il opérerait un contrôle sur les lois ⭢ il dit que la loi fait écran à son contrôle et qu’il ne peut donc pas.
CE, 1989, Nicolo : Finalement accepte, dit que les juges administratifs doivent systématiquement faire un contrôle de conventionnalité.
NB : Ce principe existait déjà sous la IVème République.
Qu’est-ce que le contrôle de conventionnalité concrètement ?
Les juges écartent l’application des lois incompatibles avec un engagement international.
Ils écartent l’application, n’abrogent pas.
On parle de contrôle de conventionnalité (notamment en écho à la convention européenne des droits de l’homme).
Mais généralement, quand une loi n’est pas conforme à un traité par rapport aux droits fondamentaux, elle ne l’est pas non plus par rapport à la Constitution.
Exemple : Cass, 15 avril 2011, sur le régime de garde à vue
Cela faisait plusieurs années que la Cour de Cassation indiquait que le régime de garde à vue n’était pas conventionnel et qu’il fallait l’écarter.
Avec cette décision, elle dit qu’elle n’ira pas plus loin dans un procès si la garde à vue n’était pas conforme.
Finalement, il y a une QPC et le CC dit que c’est pas constitutionnel.
C. LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ
En urgence et face à une décision administrative, le référé liberté
La loi du 30 juin 2000 a créé le « référé-liberté » : le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative porterait une atteinte grave et manifestement illégale.
Il est créé parce que le temps que le juge administratif statue sur une atteinte aux droits fondamentaux il est déjà trop tard.
Ex : CE, 1933, Benjamin ⭢ se plaignait de l’annulation d’une conférence, saisit le CE, le CE statue 6 mois après la date où la conférence aurait dû avoir lieu.
C’est pour que le juge décide vite pour sauvegarder les droits fondamentaux.
Il statue dans les 48h par une ordonnance qui peut être déférée en appel au Conseil d’État directement.
Ce sont des mesures provisoires, des suspensions. Il ne statue pas au fond.
Largement utilisé : En 2019, 6 975 référés-libertés ont été traités par le juge des référés (JR) des tribunaux administratifs, 352 par le juge des référés du Conseil d’Etat (JRCE).
Exemples : JRCE, 2014, Ministre de l’intérieur c/ Dieudonné M’Bala M’Bala ; JRCE, 2014, Mme Lambert.
Entre mars 2020 et mars 2021 (pandémie), 647 référés libertés devant le CE => inscrit l’urgence dans l’État de droit.