cours 21 - La classification des maladies - de la botanique à la médecine
1/35
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
36 Terms
Les classifications profanes des maladies
Centrée sur l’expérience des patients et les traitements empiriques
Systèmes de classification basés sur des observations non scientifiques et des croyances traditionnelles. Ces classifications prévalaient avant l'avènement de la médecine moderne et reflètent souvent des interprétations socioculturelles des maladies.
Les classifications savantes des maladies
Centrées sur l’observation et l’expérimentation scientifique
Basées sur des méthodes scientifiques rigoureuses et des recherches cliniques. Ces classifications s'appuient sur des critères diagnostiques objectifs et visent à fournir une compréhension précise des maladies.
Une histoire de la classification médicale
De la médecine antique à la biomédecine
Un aperçu des évolutions et des méthodes utilisées pour classifier les maladies à travers le temps, intégrant des approches traditionnelles et modernes.
Qu’est-ce qu’une maladie aujourd’hui ?
Une maladie est un état anormal du corps ou de l'esprit, souvent défini par des symptômes spécifiques et des anomalies fonctionnelles. Cela inclut des troubles physiques, mentaux et comportementaux, diagnostiqués à l'aide de critères cliniques et scientifiques modernes.
symptôme
syndrome
maladie
Le symptôme
Un signe observable ou une plainte subjective indiquant une condition médicale. Les symptômes peuvent être utilisés pour établir un diagnostic et orienter le traitement
= Signe
Le syndrome
Un ensemble de symptômes qui se manifestent ensemble et caractérisent une condition médicale spécifique. Les syndromes peuvent indiquer une maladie sous-jacente.
= Ensemble de signes
La maladie
Une condition anormale du corps ou de l'esprit, souvent associée à des signes et symptômes distincts, et qui nécessite un diagnostic médical.
= ensemble de signes avec une étiologie sous-jacente
Comment classer les maladies ?
La classification des maladies peut être réalisée en fonction de divers critères tels que l'étiologie, la pathophysiologie, l'âge d'apparition, ou la localisation de la maladie dans le corps. Cela permet aux professionnels de la santé de mieux comprendre, diagnostiquer et traiter les différentes conditions médicales.
Nosographie
Nosologie
Nosographie
Le classement des maladies en tant que tel.
La branche de la médecine qui étudie et classe les maladies en se basant sur leurs symptômes, étiologies et autres caractéristiques.
Nosologie
La théorie sous-jacente au classement des maladies.
La science qui étudie et organise les classifications des maladies, y compris leurs causes, évolutions et traitements. Elle se distingue de la nosographie par sa focalisation sur le principe et la méthode de classification.
Classification des maladies et lien avec la botanique
Selon Michel Foucault, la classification des maladies va passer “de la botanique des symptômes à la grammaire des signes”
L'étude des maladies et leur classification sont reliées à la botanique par l'utilisation de modalités de classification similaires. Cela inclut l'application de critères taxonomiques en médecine pour mieux comprendre les pathologies, souvent inspirés des systèmes de classification des espèces végétales.
Médecine des systèmes
Une tradition Hippocrato-galénique basée sur les quatre humeurs : sang, bile jaune, bile noire, et phlegme.
Médecine des espèces
Le modèle de la botanique
Une approche de la médecine qui se focalise sur des observations cliniques spécifiques et sur la classification des maladies in situ, tenant compte des symptômes individuels et des réactions des patients.
Médecine des tissus
Le point de vue anatomo-pathologique
Une approche qui se concentre sur l'étude des tissus corporels pour diagnostiquer et traiter les maladies, s'appuyant sur des observations microscopiques et l'analyse des cellules.
La modèle d’Hippocrate et de Galien
Quatre humeurs
Les maladies s’expliquent dans le cadre exclusif de ce modèle
Ces conceptions s’intègrent à un système plus général
Une approche médicale qui repose sur la théorie des quatre humeurs, considérant le corps humain comme un équilibre dynamique entre le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme.
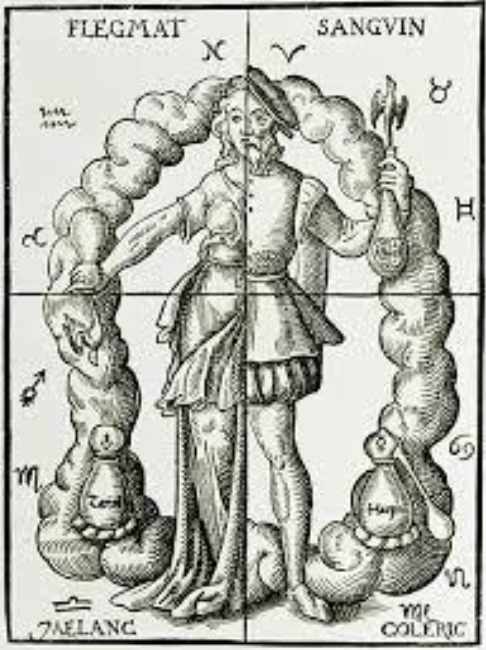
Quatre humeurs
Sang
Bile jaune
Bile noire
Phlegme
→ l’équilibre : bonne santé
→ déséquilibre : maladie

Maladies expliquées uniquement dans le modèle des quatre humeurs
Le sanguin
Le bilieux
Le mélancolique
Le flegmatique
→ Les affections qui sont interprétées exclusivement à travers la théorie des quatre humeurs d'Hippocrate et de Galien, où l'équilibre des fluides corporels détermine la santé ou la maladie.
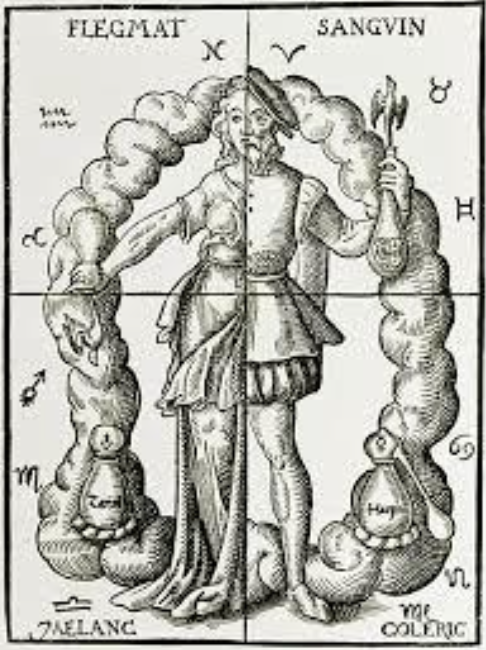
Conceptions du modèle des quatre éléments s’intègrent dans un système plus général
Quatre éléments…
air
feu
terre
eau
…correspondant à quatre états
chaud et humide
chaud et sec
froide et sèche
froide et humide
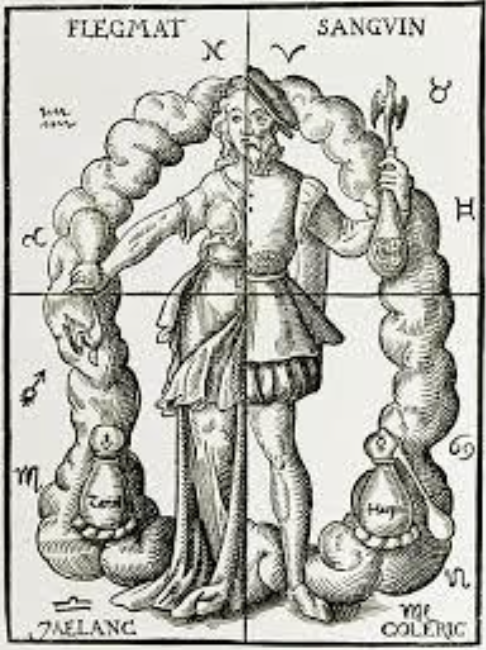
Claude Bernard (1865)
A pointé les limites de la médecine des systèmes, soulignant qu'elle s'appuie plus sur les textes que sur l'observation des faits
→ s’appuie progressivement plus sur un système de pensée que sur la clinique elle-même
La remise en cause du modèle Hippocrato-galénique
Remise en cause progressive des présupposés des systèmes hippocratiques et galéniques
Dissections - A. Vesale (1514-1564)
Circulation sanguine - W. Harvey (1578-1657)
Microscope - A. V. Leeuwenhoek (1632-1723)
Nouveaux moyens d’investigations permettant d’explorer des phénomènes jusqu’ici ignorés
→ nouveau monde qui s’ouvre aux médecins
“Nouveau monde” → va nécessiter de nouvelles méthodes de classifications
→ modèle de la botanique
Consiste à critiquer et réévaluer la théorie des humeurs de la médecine ancienne, en favorisant l'observation clinique et les approches basées sur des preuves scientifiques.
Carl von Linné (1707-1778)
Botaniste suédois connu pour établir le système de classification binomiale des espèces. Son approche a eu un impact significatif sur la médecine et la biologie en favorisant l'organisation systématique des organismes vivants.
A utilisé la classification binomiale (Genre, espèce) vs. nomenclature vernaculaire
Le modèle de Linné
Système de classification des êtres vivants basé sur des catégories taxonomiques telles que genre et espèce, but d’améliorer l'organisation et la compréhension de la biodiversité
→ classification binomiale
Choix de différencier les plantes à partir d’un critère unique
→ nombre d’organe(s) reproducteur(s)
Première classification systématique
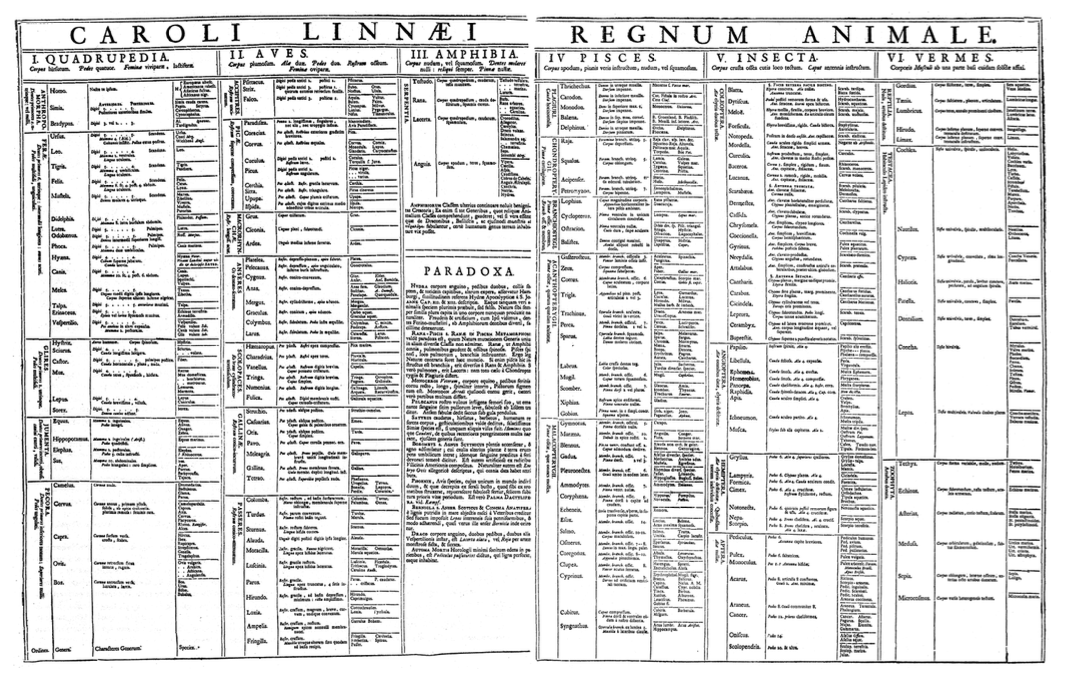
Critique du modèle de Linné
Nouvelle démarche de la botanique pour classer les plantes
→ ne plus considérer un critère unique
Les diagrammes floraux
Diagrammes floraux (Eichler, 1875)
Une nouvelle démarche pour classer les plantes en considérant la disposition relative des éléments et en liant la structure externe à la structure interne.
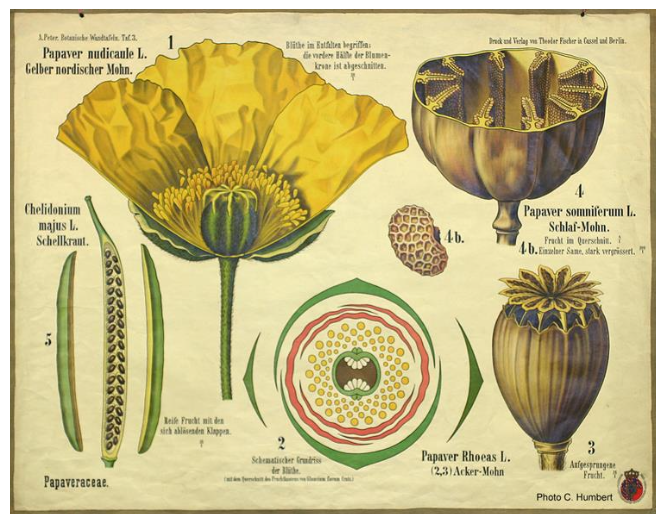
Une application du modèle de Linné
Les médecins vont s’inspirer des travaux de Linné pour classer les maladies
Ces premières classifications sont aussi motivées par un but pratique : la prédiction des épidémies
→ pour identifier et comprendre le développement d’une épidémie, il faut disposer d’un classement pertinent des maladies
S’étend de la botanique, à la zoologie et à la médecine
Le malade devient aux yeux de la médecine un “simple” porteur de la maladie
→ l’objet du médecin dès lors n’est plus seulement le malade, l’individu souffrant, mais la maladie qu’il porte
problème : profusion de signes
P. Pinel (1745-1826)
Médecin et psychiatre français, considéré comme le père de la psychiatrie moderne. Il a introduit une approche humaniste dans le traitement des maladies mentales.
A appliqué le modèle de Linné à la médecine, visant à classifier les maladies de manière pertinente pour la prédiction des épidémies.
“Le but de ma nosologie a été de prouver qu’une époque semblable [à celle de la botanique] était arrivée pour la médecine”
Livres :
Nosographie Philosophique ou Méthode de l'analyse appliquée à la médecine (1798)
Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale (1801)
Nosographie psychiatrique
Mélancolie
Manie
Démence
Idiotie
F. Boissier de Sauvages (1706-1767)
A publié le premier système nosologique en 1731, puis Nosologia methodica en 1763, comportant 2400 espèces réparties en 10 classes subdivisées en sections et en genre
Anatomopathologie
Comment comprendre et situer le mécanisme morbide ?
Le recours à l’anatomie s’est rapidement imposé pour confirmer les hypothèses tirées de l’examen clinique
Fait correspondre le 'dedans' au 'dehors', déduisant des signes extérieurs le fonctionnement et les perturbations internes
On passe d’une médecine des espèces à une médecine des tissus
Rapproche ce qui était dispersé
Disjoint ce qui semblait indistinct
→ les affections du coeur sont différenciées selon le tissus atteint
Faire correspondre le manifeste des symptômes au latent de l’altération organique
→ le symptôme n’est qu’un pâle reflet d’un singe spécifique
! on ne voit pas tout à l’autopsie → physiopathologie
Jean-Baptiste Morgagni (1682-1771)
Recherches anatomiques sur le siège et les causes des maladies (1761)
A réalisé des examens cliniques et des dissections post-mortem pour faire correspondre les signes externes avec un dysfonctionnement interne.
Xavier Bichat (1771-1802)
Refusait le diagnostic posé à partir d'une périphérie confuse, privilégiant les altérations d'un élément intérieur et central : le substrat tissulaire (signe-lésion)
Exemple de la tuberculose
La tuberculose
Exemple d'inflammation de tissus divers (poumons, cou, peau) unifiée par la présence de petits tubercules et l'identification ultérieure du bacille de Koch.
Inflammation de tissus aussi bien au niveau des poumons (phtisie), du cou (écrouelles) ou de la peau (lupus vulgaire)…
Dans tous les cas ce sont de petits tubercules dont on reconnaît ainsi les différentes formes
On identifiera plus tard l'agent responsable soit le bacille de Koch
Physiopathologie
L'observation du fonctionnement interne à partir de l'extérieur; le stéthoscope (R. Laennec)
C'est l'étude des mécanismes de développement et des conséquences des maladies sur le corps.
De l’anatomopathologie à la physiopathologie
Observer du dehors le fonctionnement interne
Le but du diagnostic médical n’est plus d’individualiser un ensemble de symptômes et de lui donner une étiquette
Médecine des espèces
Reconnaître par l’analyse des symptômes, l’existence de lésions internes
Médecine des tissus
Le médecin doit faire une sorte d’autopsie indirecte sur le corps vivant
Naissance de la clinique médicale moderne
R. Laennec (1781-1826)
Traité d’auscultation médicale (1819)
Inventeur du stéthoscope (1816), permettant de dépister les modifications significatives par l'écoute du cœur, de la respiration et de la voix.
L’écoute du coeur, de la respiration, de la voix doivent permettre de dépister les modifications signifiantes
Naissance de la clinique médicale moderne
Michel Foucault (1963)
Selon Foucault, la classification des maladies est donc passée “de la botanique des symptômes à la grammaire des signes” → Logique de la clinique
On passe d’une somme de symptômes parfois confus et souvent sans lien entre eux
logique difficile à cerner
À un ensemble hiérarchisé de signes qui attestent de lésions ou d’altérations
logique sous-jacente
Le médecin doit faire une sorte d'autopsie indirecte sur le corps vivant pour reconnaître l'existence de lésions internes
Michel Foucault (1926-1984)
Philosophe et historien français, il a analysé la relation entre le pouvoir et la connaissance, notamment dans le domaine médical
Décrit le passage de la classification des maladies « de la botanique des symptômes à la grammaire des signes »
Bilan sur les différentes médecines
Médecine des systèmes
→ classer les maladies selon la doctrine
Médecine des espèces
→ classer les maladies comme des plantes
Médecine des tissus
→ classer les maladies selon l’anatomopathologie-pathologie et la physiopathologie
Médecine et société
→ les rapports entre savoir et pouvoir