chapitre 9 - théorie de l'identité sociale
1/38
Earn XP
Description and Tags
Processus cognitifs et motivationnels dans les relations intergroupes
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
39 Terms
Catégorisation et identité sociale
Catégorisation et catégorisation sociale
Théorie de l’identité sociale
Le paradigme des groupes minimaux
Identité sociale et identité personnelle
Représentations de groupes
Statut social
Prototypicalité
L’homogénéité de l’horsgroupe
Horsgroupe / Exogroupe / Outgroup
Groupe de non-appartenance
Intragroupe / Endogroupe / Ingroup
Groupe d’appartenance
Ambiguïté “Intragroupe”
Intragroupe vs. Horsgroupe
Intragroupe vs. Intergroupe
Cognition et catégorisation
À partir de 1960 : “Révolution cognitive”
Intelligence artificielle, ordinateurs
Développements médicaux, neurologiques, sciences de l’esprit et du cerveau
→ changement de paradigme scientifique
⇒ perception remplace comportement comme objet d’étude
→ Les fonctionnements cognitifs renvoient aux activités d’élaboration et de traitement de l’information
Catégorisation
Processus psychologique qui ordonne l’environnement en termes de catégories : groupe de personnes, objets, événements
Découpage de l’environnement en regroupant les objets qui sont ou qui paraissent similaires
Les éléments d’un groupe sont similaires ou équivalents par rapport à un critère de catégorisation déterminé
Ce critère désigne “l’identité du groupe” par le biais du nom de la catégorie
Fonctions de la catégorisation
Structuration de l’environnement
Systématisation et découpage
Simplification
Attribution de signification aux éléments isolés
Le tout est plus que la somme des parties…
Une catégorie englobe des explications, des théories naïves (une «étiquette catégorielle» est porteuse de signification, car considérée comme «importante»)
Prévisibilité et ordre (la connaissance de l’appartenance catégorielle permet d’expliquer et d’anticiper le comportement)
Différenciation catégorielle - Tajfel & Wilkes (1963)
Accentuation des différences entre catégories et réduction des différences à l’intérieur des catégories
Les huit lignes sont présentées aux sujets une par une entre 6 et 11 fois, de façon aléatoire
Les sujets doivent estimer la longueur de chaque ligne
3 conditions expérimentales:
avec lettres (A, B) désignant deux catégories de lignes (petites vs. Grandes)
avec lettres réparties aléatoirement par rapport aux lignes
sans lettres
Hypothèse:
dans la condition avec lettres correspondant aux catégories, les différences entre catégories sont surestimées

Résultats de l’expérience de différentiation catégorielle
Dans la condition « avec lettres », la différence entre la ligne A la plus courte et la ligne B la plus longue est surestimée.
Accentuation des différences entre catégories A et B, réduction des différences à l’intérieur des catégories
→ Différenciation catégorielle simple (sans appartenance groupale)
Henri Tajfel (1919-1982)
Psychologue britannique connu pour ses travaux sur la théorie de l'identité sociale, notamment la différenciation catégorielle et les expériences sur l'appartenance sociale.
Cognitive aspects of prejudice - Tajfel (1969)
Principe des jugements de stimuli physiques appliqué à la catégorisation de personnes, augmentant les différences perçues entre les catégories et les similitudes à l’intérieur d’une catégorie
En 1969, Tajfel applique le principe des jugements de stimuli physiques à la catégorisation de personnes
Augmentation perçue des :
Différences entre les catégories
Similitudes à l’intérieur d’une catégorie
Théorie expliquant l’holocauste
→ n’est pas “inné” selon lui (opposition avec ce qui est dit)
Débuts de la théorie de l’identité sociale (Début TID)
Les individus cherchent à comprendre et à donner du sens à leur environnement social; hypothèse d’une certaine rationalité collective
Décrit les principes de la psychologie sociale cognitive appliqués aux relations intergroupes
Toute catégorie sociale est d’abord une catégorie cognitive
→ les catégories n’existent pas tant qu’on ne les perçoit pas
Les individus cherchent à comprendre et à donner du sens à leur environnement social
Hypothèse d’une certaine rationalité collective, contraire aux théories biologisantes qui expliquent l’agressivité avec des instincts innés
Théorie des préjugés (Début TID) - Tajfel (1969)
Une théorie des préjugés doit pouvoir expliquer dans quelles conditions l’agressivité se développe :
Tenir compte du contexte social et historique
Examiner les croyances et attitudes que les groupes entretiennent les uns par rapport aux autres
Une théorie ne doit pas pouvoir être utilisée pour justifier l’existence de discrimination
Approche cognitive des préjugés (Début TID)
Les préjugés sont le produit d’une pensée rationnelle qui cherche à donner du sens, par le biais de catégories sociales qui rendent le monde cohérent et intelligible
Préjugés = simplifications, catégorisations
Postulat motivation de la préservation d’une image positive du soi
Tajfel vs. Sherif
L’approche cognitive des préjugés (Tajfel) conteste l’explication de la discrimination par la compétition réelle (Sherif)
Argument de Tajfel: Chez Sherif, les perceptions négatives envers le horsgroupe sont apparues avant même que soit introduite la compétition entre les groupes
Donc: pour Tajfel, les préjugés peuvent se développer même sans relations de compétition
Hypothèse de base concernant l’identité sociale
La seule représentation de l’appartenance à deux groupes distincts entraîne une discrimination en faveur du groupe d’appartenance
Objectif de Tajfel : explorer les conditions minimales faisant émerger une représentation d’appartenance à un groupe, pouvant ainsi déclencher la discrimination intergroupe
Paradigme des groupes minimaux PGM (1971)
Le PGM avait pour but d’éliminer les facteurs sociologiques, économique, historiques et idéologiques reconnus (à l’époque) comme étant les causes majeures de la discrimination entre les groupes
→ Conditions minimales d’émergence de discrimination
→ approche «cognitive» de la discrimination.
La discrimination dans le PGM
Dans la catégorisation de personnes, les individus font eux-mêmes partie d’une catégorie (contrairement aux stimuli physiques de Tajfel et Wilkes (1963))
Les différences perçues entre et à l’intérieur des catégories ne sont plus neutres, mais deviennent évaluatives (motivation d’une évaluation positive de soi)
→ “Favoritisme de l’intragroupe” et “discrimination de l’horsgroupe” comme produits de processus cognitifs et motivationnels
Caractéristiques PGM
Deux groupes répartis de façon arbitraire (pile ou face)
Aucune histoire de conflit d’intérêts entre ces groupes formés pour les besoins de l’expérience
Anonymat des participants, ce qui élimine les effets possibles des affinités et des conflits interpersonnels
Aucune interaction entre les participants
Absence de lien instrumental entre les réponses des participants et leur intérêt personnel
Mise en opposition directe de stratégies de distribution favorisant l’endogroupe des stratégies visant le gain maximum pour tous ou la parité
Tajfel, Billig, Bundy & Flament (1971)
48 garçons répartis en deux groupes, en fonction de préférences esthétiques fictives (groupe Klee et groupe Kandinsky)
Tâche: Attribuer des « points » aux groupes
Chaque sujet remplit individuellement 44 matrices différentes de répartition de points
prétexte d'être associer à un on l'autre des groupe → aléatoire
Exemple de matrice - étude TBBF
Le sujet doit choisir une colonne qui définit simultanément les points attribués aux membres des deux groupes (par ex. 15 pts pour X [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe]) [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe])
Les matrices comparent soit deux membres du même groupe (intra-intra; hors-hors), soit deux membres de groupes opposés (intra-hors)
Les matrices sont construites afin de déterminer les stratégies de répartition de points privilégiées par les sujets dans différentes configurations entre groupes
![<ul><li><p>Le sujet doit <strong>choisir une colonne </strong>qui définit simultanément les points attribués aux membres des deux groupes <em>(par ex. 15 pts pour X [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe]) [horsgroupe] et 9 pts pour Y [intragroupe])</em></p></li><li><p class="p1">Les matrices comparent soit deux membres du même groupe (intra-intra; hors-hors), soit deux membres de groupes opposés (intra-hors)</p></li><li><p class="p1">Les matrices sont construites afin de déterminer les <strong>stratégies de répartition </strong>de points privilégiées par les sujets dans différentes configurations entre groupes</p></li></ul><p></p>](https://knowt-user-attachments.s3.amazonaws.com/0df58aeb-ba96-48e5-8b0e-0b95159d65ad.png)
PGM : Stratégies
Stratégies principales de distribution de points entre deux groupes
RCM
RIM
DM
RCM
Récompense Commune Maximale
→ total des points le plus élevé possible
RIM
Récompense Intragroupe Maximale
→ le plus grand nombre de points possible pour l’intragroupe
DM
Différence maximale
→ la plus grande différence possible entre les points attribués aux membres des deux groupes, en faveur de l’intragroupe
Exemple de matrice de stratégies indifférenciées
→ tableau qui illustre les gains potentiels d'un groupe par rapport à un autre dans différentes situations, sans tenir compte des différences entre les membres.
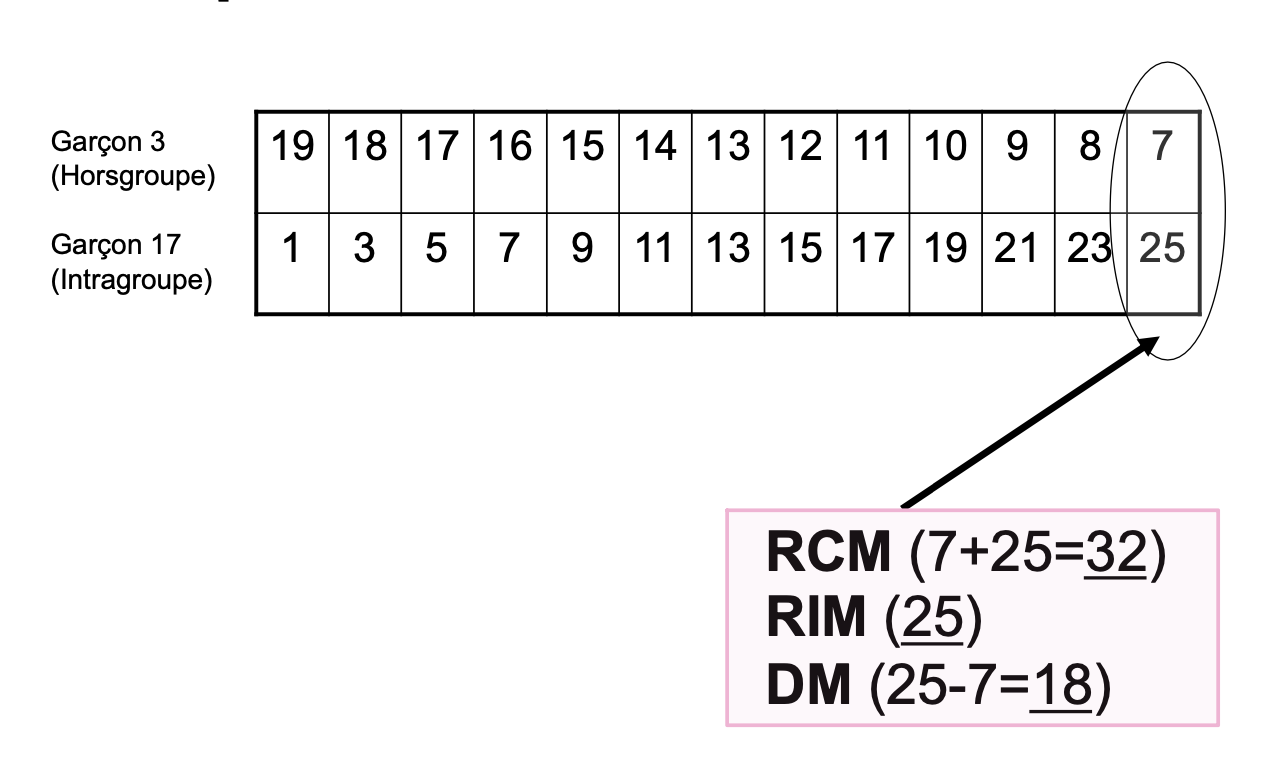
Exemple de matrice de stratégies différenciées
→ un tableau qui montre comment les points peuvent être distribués de manière différente entre les membres de chaque groupe, afin de maximiser les avantages pour l’intragroupe.
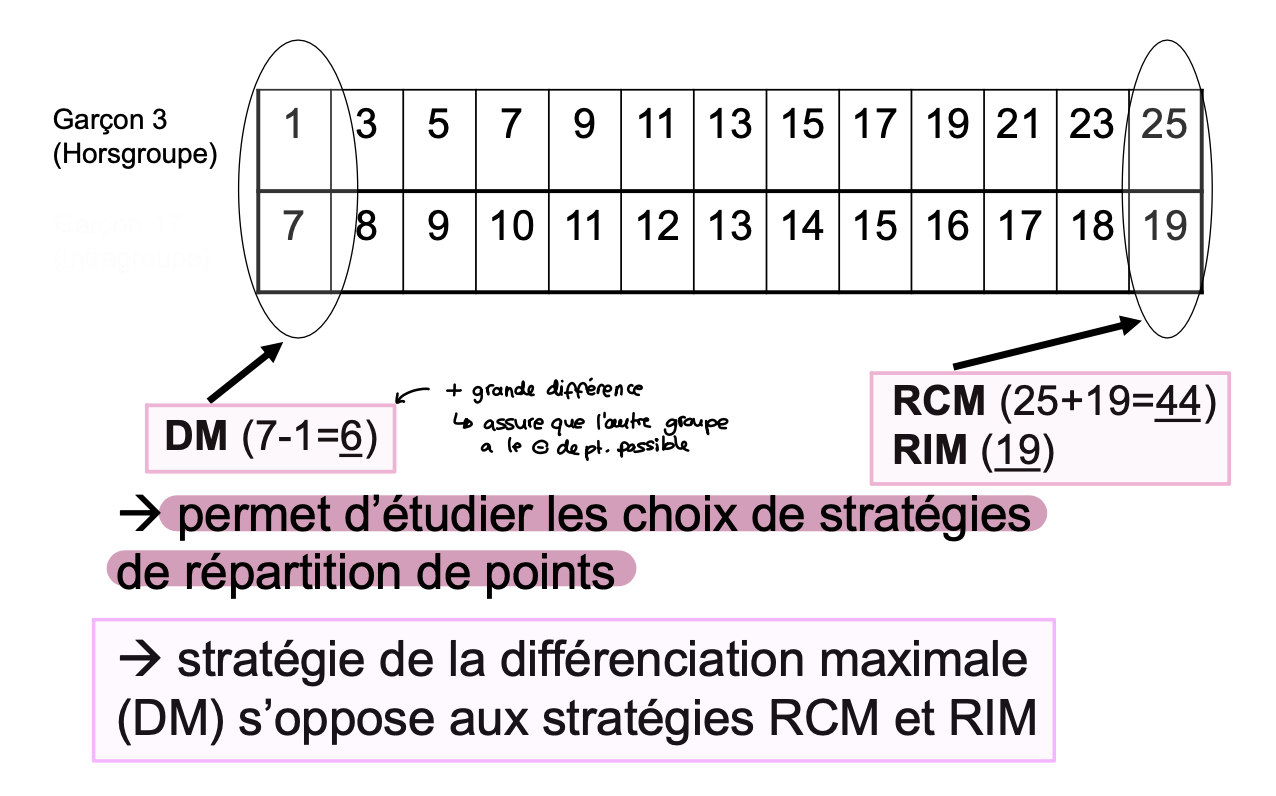
Résultats principaux PGM
Pour les matrices proposant l’allocation de points aux membres du même groupe (intra-intra; hors-hors), la solution du bénéfice maximal est préférée (RCM)
Pour les matrices proposant l’allocation de points à deux membres de groupes différents, les sujets privilégient clairement des solutions favorisant leur propre groupe (RIM > RCM) [matrices sans possibilité de DM]
Pour les matrices qui permettent aux sujets de différencier (positivement) leur groupe du horsgroupe, ils le font même au détriment du gain absolu (DM > RCM / RIM)
Discussion PGM
Cette situation minimale suffit pour que les sujets se comportent en fonction de leur appartenance au groupe et provoque ainsi le favoritisme intragroupe
Ni la compétition réelle, ni le bénéfice individuel peuvent expliquer ces résultats
Ce biais peut aller jusqu’à amener l’intragroupe à préférer de gagner moins pourvu qu’il gagne plus que le horsgroupe
Conclusion PGM
Le favoritisme intragroupe repose à la fois sur les aspects cognitifs (différenciation) et motivationnels (valorisation) → identité sociale positive
Différentiation (aspects cognitif)
Valorisation (aspect motivationnel)
Différentiation (aspects cognitif)
Le groupe d’appartenance doit apparaître différent des autres groupes sur les dimensions jugées positives et importantes pour les membres du groupe (dans le PGM: les points)
Valorisation (aspect motivationnel)
Plus les comparaisons avec le horsgroupe sont positives, plus les membres de l’intragroupe bénéficient d’une identité sociale positive
Concepts-clef de la théorie de l’identité sociale
Identité
Catégorisation sociale
Comparaison favorable
Identité
Recherche d’une identité sociale positive
L'identité se réfère à l'ensemble des caractéristiques et des valeurs qui définissent un individu, influencées par son appartenance à différents groupes sociaux et cultures.
Catégorisation sociale
Différenciation en EUX et NOUS
Processus par lequel les individus classifient les autres, ainsi qu'eux-mêmes, en groupes sociaux afin de simplifier la perception des relations sociales.
Comparaison favorable
avec un horsgroupe pertinent
Processus où les individus évaluent leurs groupes en les comparant à d'autres groupes, afin de maintenir ou d'améliorer leur estime de soi.
Identité sociale résultant du processus de catégorisation
La partie de soi des individus qui provient de leur connaissance de leur appartenance à un groupe social, associée à la valeur et à la signification émotive de cette appartenance - Tajfel (1981)
Sherif vs. Tajfel
La théorie des conflits réels et la théorie de l’identité sociale proposent des lectures différentes, mais tout aussi légitimes, de la réalité sociale
Motivations instrumentales (compétition intergroupe) vs. Symboliques (représentations intergroupes)
Compétition objective (ressources limitées) vs. subjective (comparaison favorable)
Similarité intergroupe : Positive (→ augmenter l’harmonie) vs. Négative (→ comparaison favorable ⇒ distinction pour notre groupe : identité sociale positive)
Relation intergroupe comme facteur causal (VI) (→ explique le vécu) ou résultante (VD) (→ résultat de processus psychologiques) des processus psychologiques associés aux relations intergroupes
Le double regard de la SIT
La SIT est une théorie qui explique…
L’origine des préjugés et de la discrimination
→ perspective “majoritaire”, dominante
Les réactions des groupes dominés fac à leur situation défavorisée (donc à leur identité sociale négative)
→ perspective “minoritaire”, dominée
Créativité collective
min groupe défavorable → max groupe favorable