Exam final psychocrimino
1/45
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
46 Terms
Définition du béhaviorisme
Approche psychologique:
Béhaviorisme se concentre sur l'étude des comportements observables, contrairement aux approches qui analysent les pensées ou les motivations profondes.
Apprentissage par l'expérience:
Nous ne naissons pas criminels, nous le devenons par l'interaction avec notre environnement et les expériences que nous accumulons.
Conditionnement classique (Pavlov)
Apprentissage par association:
Association automatique, où un stimulus neutre devient un déclencheur automatique d’une réponse. Un conditionnement peut être affaibli ou supprimé; si le stimulus conditionné (cloche) est présenté sans le stimulus inconditionnel (nourriture) de manière répétée, la réponse conditionnée (salivation) disparaît progressivement.
Conditionnement opérant (Skinner)
Apprentissage par conséquence (récompense/punition):
Les comportements sont modifiés par les renforcements et punitions qu’ils entraînent. Il est donc possible d’éteindre un comportement en réduisant les renforcements qui le maintiennent.
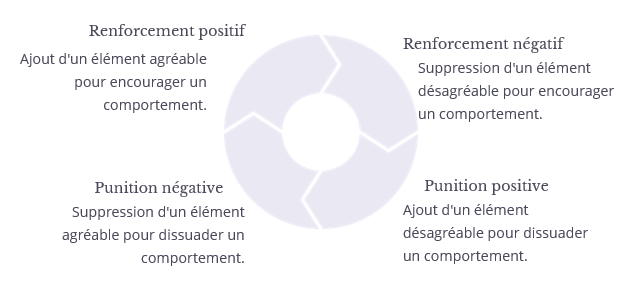
Renforcement différentiel (Jeffery)
Comportement est adopté si les bénéfices perçus surpassent les conséquences négatives:
Le crime est un comportement appris, mais qui ne repose pas uniquement sur la punition et le renforcement extérieur. Principes:
Bénéfices perçus: si un individu perçoit plus de bénéfices que de risques dans un acte criminel, il est susceptible de le commettre
Risques perçus: si un individu perçoit plus de risques que de bénéfices, il est moins enclin à commettre un acte criminel
3 facteurs:
Renforcements positifs perçus (récompenses du crime)
Renforcements négatifs perçus (échapper à une conséquence négative)
Punition perçues (conséquences négatives du crime)
Donc, pour éliminer un comportement, il faut modifier la balance des renforcements.
Conditionnement vicariant (Bandura)
Apprentissage par imitation:
Mécanisme du conditionnement vicariant:
L'attention: l'individu observe un modèle (un adulte, une célébrité, un criminel respecté dans son entourage)
La rétention: l'individu mémorise le comportement observé et les conséquences qui en découlent.
La reproduction: lorsqu'il se retrouve dans une situation similaire, il reproduit le comportement appris.
La motivation: si le comportement semble récompensé, il sera adopté durablement. Si le comportement est sanctionné, il peut être abandonné.
Si un individu est exposé à des modèles positifs, il peut apprendre d’autre comportements.
Limites & critiques des approches béhavioristes
Ces théories béhavioristes n'expliquent pas pourquoi certains individus, exposés aux mêmes environnements criminogènes, résistent à l'apprentissage criminel.
Ces théories négligent trois dimensions majeures : les biais cognitifs, le contexte culturel, et les déterminants structurels
Elles ne suffisent pas à expliquer toutes les formes de délinquance, et doivent être complétées par d'autres approches
Approche cognitivo-comportementale
Idée selon laquelle les pensées, émotions et comportements sont interconnectés. Cette approche est utilisée à la fois pour comprendre les causes de la délinquance et pour développer des stratégies d’intervention.
Postulat: les compts. criminels ne sont pas uniquement appris, mais aussi influencés par la façon dont l'individu perçoit et interprète son environnement.
Théorie de l’association différentielle (Sutherland)
Théorie: Le comportement criminel s'apprend par la communication et l'association avec d'autres criminels/délinquants, où l'on apprend des techniques et des méthodes, ainsi que de nouvelles attitudes et motivations pour commettre un crime.
3 idées centrales
Le crime est un comportement appris au sein de groupes restreints (famille, amis, pairs, gangs)
L'apprentissage comprend les techniques du crime, mais aussi les motivations et justifications du comportement criminel
Un individu devient criminel lorsqu'il est exposé à plus de définitions favorables au crime qu'à des définitions favorables à la loi.
Importance des définitions favorables ou défavorables à la loi
Idée: l'exposition au définitions du crime détermine si un individu deviendra criminel
Définitions favorables au crime justifient, normalisent ou valorisent le compt.
Définitions défavorables au crime condamnent et découragent le passage à l'acte.
9 principes de l’association différentielle (Sutherland)
Comportement criminel est appris.
Appris par l'interaction avec d'autres individus.
Se fait au sein de groupes restreints.
Apprentissage inclut les techniques du crime et les motivations et justifications.
L'orientation d'un individu vers un comportement criminel dépend des définitions favorables ou défavorables à la loi.
Une personne devient criminelle lorsqu’elle est exposée à plus de définitions favorables au crime qu’à des définitions défavorables.
L’association différentielle varie en fonction de la fréquence, de la durée, de la priorité et de l’intensité des interactions avec des modèles criminels.
Le processus d’apprentissage du crime suit les mêmes mécanismes que tout autre apprentissage.
Le crime ne peut pas être expliqué uniquement par les besoins généraux et les valeurs : des personnes vivant les mêmes conditions économiques ne deviennent pas toutes criminelles.
Limites et critiques de la théorie de l’association différentielle
Limites et critiques de la théories de l'association différentielle
Théorie qui sous-estime les différences individuelles
Traits de personnalité
Histoire personnelle et expériences précoces
Capacités cognitives
Modèle trop rigide et quantitatif de l'apprentissage criminel
Focalisation excessive sur l'apprentissage social, sans prise en compte des renforcements et punitions
Absence de prise en compte des structures économiques et sociales
Inégalités économiques
Influence des institutions
Opportunités criminelles
Théorie qui s'applique mal aux crimes en col blanc (n'existaient pas quand la théorie a été développée)
Théorie de l’apprentissage social (Akers)
Théorie: Le crime et les comportements déviants sont appris au travers des interactions sociales, en intégrant les principes du renforcement différentiel, de l’imitation, des définitions favorables et des associations différentielles.
Principes:
L'association différentielle (Sutherland): individu est exposé à des groupes qui lui transmettent des normes et des valeurs (famille, amis, pairs, médias, gangs)
Les définitions (Sutherland): développe des croyances et justifications qui l'amènent à percevoir certains compts. comme acceptables ou inacceptables.
Le renforcement différentiel (Jeffery): compt. est maintenu ou abandonné en fonction des récompenses ou des punitions qu'il reçoit
L'imitation (modélisation comportementale): individu observe et reproduit les compts. d'autrui, surtout ceux de personnes perçues comme des modèles
Extension de la théorie de Sutherland
2 mécanismes clés:
L'imitation: individu reproduit un compt. observé chez d'autres, surtout s'il perçoit l'auteur de ce comportement comme un modèle de réussite ou de pouvoir.
Le renforcement différentiel: la poursuite ou l'abandon d'un compt. dépend des récompenses ou punitions qu'il reçoit après l'avoir adopté.
Limites et critiques de la théorie de l’apprentissage social
Sous-estimation du libre arbitre
Modèle trop mécanique
Difficulté à expliquer les crimes en col blanc
Théorie des distorsions cognitives (Beck)
Postulat: Les distorsions cognitives sont des erreurs systématiques de raisonnement, des biais de pensée qui conduisent un individu à mal interpréter la réalité et à justifier des comportements inadaptés, y compris criminels.
Schémas cognitifs: structures automatiques, inconscients, et difficiles à modifier, de représentations des connaissances et des expériences antérieures inscrites en mémoire à long terme (MLT).
Schémas génèrent à la fois les émotions, les cognitions et les comportements.
Mécanisme clé : Un individu perçoit une situation → Il l’interprète à travers ses schémas cognitifs → Si ses schémas sont biaisés, il adopte une perception erronée de la réalité, ce qui peut légitimer un acte, criminel.
Les distorsions cognitives peuvent être à la fois une cause du crime et une conséquence.
Principaux types de distorsions cognitives
Rationalisation
Projection de la faute sur autrui
Minimisation des conséquences
Raisonnement dichotomique (tout ou rien)
Exagération des injustices subies
Catastrophisme
Personnalisation
Surgénéralisation
Raisonnement émotionnel
Limites et critiques des distorsions cognitives
un modèle trop général
un biais d’interprétation
un manque de prise en compte des émotions
Théore de l’impuissance apprise / acquise (Seligman)
Théorie : lorsque des individus sont confrontés à des échecs répétés ou à un environnement inchangeable, ils peuvent apprendre à ne plus essayer d’améliorer leur situation, même si des solutions existent.
Cet état se caractérise par :
Une perte de motivation à agir.
Une résignation face aux problèmes.
Une diminution de l’initiative et de la capacité à chercher des solutions.
Idée: L’impuissance acquise peut jouer un rôle central dans le développement et le maintien des comportements criminels, en influençant la perception qu’un individu a de sa capacité à modifier sa trajectoire de vie.
Limites et critiques de la théorie de l’impuissance acquise (Seligman)
Généralisation excessive des expériences animales
Approche trop individualiste et sous-estimation des facteurs sociaux
Difficulté à expliquer pourquoi certaines personnes résistent à l'impuissance acquise
Sous-estimation des stratégies de résilience et des interventions extérieures
Manque de prise en compte de la dimension émotionnelle et motivationnelle
Limites culturelles: modèle occidental pas toujours généralisable
3 objectifs principaux des interventions TCC en crimino
Modifier les croyances erronées et les distorsions cognitives
Méthode en plusieurs étapes:
identification des pensées automatiques erronées
prise de conscience et remise en question (ex: questionnement socratique)
développement d’alternatives cognitives réalistes
application des nouvelles pensées dans des situations réelles
Développer des habiletés sociales et émotionnelles
Méthodes utilisées:
exercices de gestion de la colère (ex: techniques de respiration et relaxation)
jeux de rôles pour pratiquer des interactions sociales positives (ex: mises en situation dirigées)
modélisation et renforcement positif pour encourager des comportements prosociaux (ex: observation de modèles prosociaux)
Mettre en place des stratégies de prévention de la récidive
Méthodes utilisées:
mise en situation et jeux de rôle simulant des scénarios à risque (ex: jeux de rôles encadrés)
techniques de prévention de la rechute, inspirées des traitements des addictions (ex: analyse des situations à haut risque)
accompagnement progressif vers une réintégration sociale stable (ex: plan de réinsertion structuré)
3 formes d’intervention en TCC appliqués à la criminologie
Intervention individuelles
restructuration cognitive (ex: journal de pensées criminogènes)
techniques d’autorégulation (ex: pratique de la prise de recul)
planification et engagement personnel (ex: fixation d’objectifs SMART)
Interventions de groupes
TCC de groupe
Modules d’éducation et de formation sur la gestion des comportements délinquants
Programme ART (cible violence et impulsivité)
Interventions multimodales
Intégration des TCC avec suivi psychiatriques
Approhces combinées avec la justice restaurative
Supervision et suivi-post-carcéral structuré
Facteurs influençant l’efficacité d’un traitement
Motivation du délinquant et engagement dans le traitement
Contexte institutionnel et conditions de mise en oeuvre
milieu carcéral
milieu semi-ouvert (probation / LC)
milieu communautaire (suivi externe post-incarcération)
Profil criminologique et psychopathologique du délinquant
Défis concrets de la mise en oeuvre des programmes en milieu institutionnel
Défis institutionnels des TCC en milieu correctionnel
contraintes budgétaires
manque de formation des intervenants
résistance des participants
pression du système judiciare
Limites, débats et enjeux éthiques
Les TCC peinent à modifier les schémas cognitifs des psychopathes élevés (score PCL-R ≥ 30) , en raison d’un déficit d’empathie structurel (Hare, 2020).
L’utilisation des TCC en criminologie soulève des questions éthiques, notamment sur l’application coercitive des programmes en milieu carcéral. De plus, des critiques pointent des biais culturels dans les outils d’évaluation (ex. LS/CMI), qui pourraient surévaluer le risque chez les minorités ethniques.
Trouble de la personnalité antisociale
Le TPA est un trouble de la personnalité, ce qui signifie que les pensées, les émotions et les comportements de la personne sont :
Durablement rigides (peu adaptables),
Dysfonctionnels (provoquent des conflits avec l’environnement),
Et surtout, source de souffrance pour elle-même et pour les autres.
TPA ≠ simple rébellion
Caractère auto-destructeur et persistant des comportements:
Plus d'accidents, de blessures, de tentatives de suicide
Moins de suivi médical
Mortalité accrue (accidents, suicides, homicides)
Critères du profil antisocial (modèles dimensionnels - facettes de la personnalité)
insensibilité
impulsivité
manipulation
malhonnêteté
Robert D. Hare
Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R)
La psychopathie est « un trouble de la structure émotionnelle et relationnelle ».
Ce qui est altéré chez une personne psychopathe, ce sont :
Les émotions
La manière de se lier à autrui
La conscience morale
Sa définition a donc contribué à faire de la psychopathie une entité clinique à part entière
Craig Neuman
Approche factorielle regroupant les 20 items du PCL-R en deux grands facteurs :
Facteur 1 : Traits interpersonnels et affectifs (manipulation, absence d’empathie, égocentrisme)
Facteur 2 : Comportements antisociaux et style de vie (impulsivité, irresponsabilité, instabilité)
Approche dimensionnelle, où la psychopathie serait présente à des degrés divers dans la population
La psychopathie devient alors un continuum, un peu comme la taille ou l’anxiété :
Tu peux être un peu, modérément, ou très psychopathe
Tu peux aussi présenter certains traits, mais pas tous
Keri Kossom
Traits «callous-unemotional»
Ne pas montrer de remords quand ils blessent quelqu'un
Être peu sensibles aux émotions des autres
Être froid, distants, manipulateurs, parfois cruels
Une hypothèse évolutionniste: des traits "utiles" dans des environnements hostiles?
Différences cérébrales :
Un système limbique sous-actif
Une faible connectivité entre les zones émotionnelles et cognitives
Kossom contribue à changer notre regard sur la psychopathie :
Ce n’est pas juste "du mal pur"
C’est une construction neuro-développementale complexe
Qui peut apparaître très tôt chez certains enfants
Et qui fonctionne différemment au niveau cérébral
Mais qui, dans certains contextes, aurait pu être utile
PCL-R
Psychopathy Checklist - Revised
Outil d’évaluation clinique standardisé, utilisé principalement :
en milieu carcéral ou médico-légal
pour évaluer les risques de récidive violente
pour orienter des décisions judiciaires ou correctionnelles
Repose sur 20 items, répartis en deux grands facteurs
Seuils cliniques (Selon Hare)
≥ 30 : profil de psychopathie clinique (en Amérique du Nord)
25–29 : traits psychopathiques élevés
< 20 : peu ou pas de traits
Forces et limites de la PCL-R
Forces de la PCL-R
Standardisation rigoureuse
Utilisation prédictive
Cadre clinique clair
Permet d'identifier des profils différenciés
Limites et critiques
Stigmatisation possible
Risque d'abus en milieu judiciaire
Pas conçu pour des populations non-criminelles
Pas un outil de diagnostic psychiatrique en soi
Difficultés cliniques et criminologiques de la psychopathie
Faible motivation au changement
Absence de souffrance perçue
Objectifs extérieurs à la thérapie (libération, avantages)
Risque d’illusion de progrès
Manipulation du cadre
Utilisation stratégique du dispositif thérapeutique
Mise à l’épreuve des intervenants
Risque accru si le cadre est flou ou permissif
Alliance thérapeutique fragile
Relation souvent instrumentalisée
Risques d’épuisement ou de désengagement des professionnel·le·s
Danger émotionnel si alliance factice
Typologies “classiques” de délinquants
proviennent d’une tradition clinique ou judiciaire bien ancrée ;
sont utilisées dans les milieux juridiques, psychiatriques et criminologiques ;
cherchent à classer les individus selon la nature de leur passage à l’acte.
Délinquant:
Accidentel
Souffrant de troubles mentaux
Névrosé conflictuel
Occasionnel
Professionnel
Antisocial
Typologies complémentaires de délinquants
Délinquant:
Idéologique / politique
Chronique / habitude
Victime / coercif
Type de passage à l’acte
Type de passage à l’acte | Motivation principale | Exemples |
Expressif | Émotion forte, impulsion, explosion | Agression lors d'une dispute, vandalisme impulsif |
Instrumental | Objectif concret, planifié, stratégique | Vol prémédité, braquage, sabotage |
Défis des interventions policières traditionnelles
Escalade de la violence: Les interventions peuvent intensifier la crise plutôt que l'apaiser.
C’est ce qu’on appelle une escalade de la violence : plus l’intervention est mal adaptée, plus la situation dégénère. = en l’absence de détection adéquate des symptômes (ex. : hallucinations, désorganisation cognitive, désorientation), une intervention fondée sur la contrainte physique peut provoquer une réaction de panique, de fuite ou d’agressivité défensive.
Stigmatisation: Renforce les préjugés envers les personnes vivant avec un trouble mental.
Formation insuffisante: Manque de préparation spécifique aux situations de crise psychologique.
Risques élevés: Judiciarisation ou usage excessif de la force trop fréquents.
Équipe mixtes
Présence conjointe: Patrouilles ou interventions ciblées sur le terrain.
Rôle du policier: assurer la sécurité, évaluer les risques
Rôle de l'intervenant: évaluer l'état mental, désamorcer la crise.
Objectif commun: éviter l'escalade, orienter vers les soins
Équipe mixte: solution pansement
Inégalités d'implantation: services disponibles surtout en milieux urbains
Perception mitigée: un uniforme policier rassure certains, mais en effraie d'autres
Sous-financement: manque chronique de ressources pour les services psychosociaux
Confusion des rôles: risque de mélange entre fonction d'aide et de contrôle
Terrorisme
«l’utilisation ou menace d’utilisation illégale de la force ou de la violence par une personne ou un groupe organisé, contre des personnes ou des biens, avec l’intention d’intimider ou de forcer des sociétés ou des gouvernements, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques »
Radicalisation
« processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social, ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel » (Khosrokhavar, 2014)
Démarche d’adhésion volontaire
Idéologie exclusive
Pensée radicale + action radicale (violence)
Toutes les radicalités ne mènent pas à la violence.
Des mouvements abolitionnistes, écologistes ou féministes ont été qualifiés de radicaux… sans être violents.
La radicalisation violente implique l’adoption d’une idéologie extrême + volonté d’agir par la violence.
Il y a des radicaux pour la paix, la justice ou l’environnement. Ce n’est pas le radicalisme qui est problématique, c’est l’appel à la violence.
Signes de radicalisation
rupture avec les proches : famille, amis
rupture avec l’école : déscolarisation soudaine
nouveaux comportements alimentaires/vestimentaires/linguistiques/financiers
nouveaux comportements identitaires : propos asociaux, rejet de l’autorité et de la vie en collectivité
repli sur soi
fréquentation de sites internet et réseaux sociaux à caractère radical/extrémiste
Facteurs individuels en lien avec la radicalisation
Pas nécessairement un faible niveau économique, social et scolaire
Pas de lien avec la santé mentale ; “normalité” (Crenshaw, 1981)
Insuffisance des facteurs individuels - voir les modèles psycho-sociologiques
Modèle psycho-sociologique de l’escalier vers le terrorisme (Moghaddam)
Première marche souligne l’aspect cognitif
À chaque étape, de + en + d’efforts à fournir
La plupart s’arrêtent avant la dernière marche - pensée radicale mais pas d’action radicale
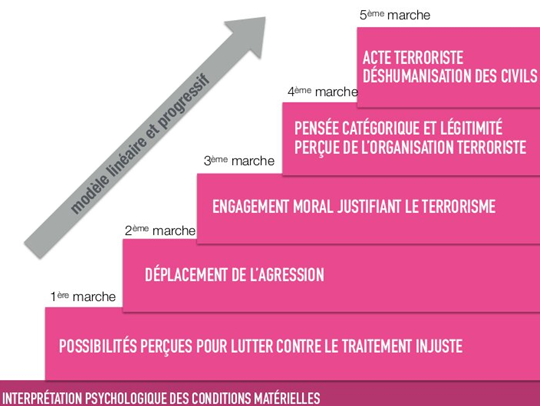
Modèle psycho-sociologique d’adhésion aux groupes extrémistes (Wiktorowicz)
Élément déclencheur : crise inattendue comme point de départ à la radicalisation
Influence des “messagers” extrémistes
Quête d’identité, de socialisation
Limites : modèles linéaires de niveau macro (individuel), évolution méthodique et ordonnée
Phénomène multidimensionnel : dynamique psychologique, sociale et environnementale interdépendante, qui varie au cours du temps en fonction de l’individu
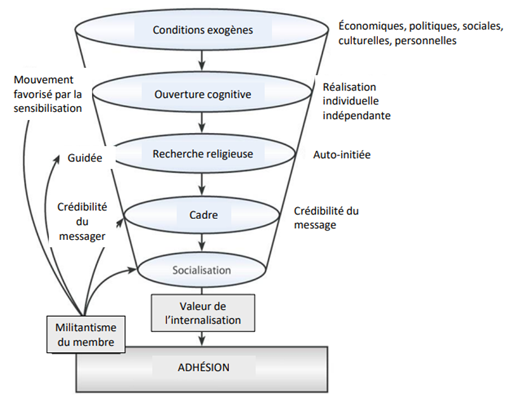
Modèle psycho-sociologique des 3 N (Kruglanski, Bélanger & Gunaratna)
Modèle multifactoriel basé sur la quête de signification/d’identité
Les trois “N” :
Needs (besoins)
Narratives (récits)
Networks (réseaux)
Multiplicité des facteurs
Conjonction de 3 facteurs : le contexte social, la trajectoire individuelle et la rencontre avec un groupe radical
Facteurs de risque ?
niveau personnel interne : quête d’identité, besoin d’appartenance...
niveau personnel externe : variables économiques, démographiques et sociales
niveau contextuel : interprétation du monde, sentiment d’indignation morale...
Approche individuelle : analyser la façon “dont un individu évolue vers des croyances radicalisées au fil du temps dans un environnement social fluide et en constante évolution” (Constanza, 2012)
Déradicalisation
Objectifs :
défaire le processus de radicalisation par une transformation identitaire
encourager la réintégration de ces individus dans la société
Désengagement vs déradicalisation (pensée radicale vs action radicale)
Outil stratégique : briser le cycle de la violence
Approche interventionniste
2 processus (désengagement vs déradicalisation)
| Désengagement | Déradicalisation |
Définition | Abandon des actions violentes | Abandon de l’idéologie violente |
Changement d’idées ? | Pas nécessaire | Oui, remise en question profonde |
Risque de récidive | Plus élevé | Moins élevé (si processus réussi) |
Objectif principal | Éviter l’action / la violence | Réintégration sociale et cognitive |
Exemple | Une personne ne commet plus d’attentat, mais pense que la violence est parfois justifiée | Une personne rejette l’idéologie et veut reconstruire sa vie |
On peut être désengager sans être déradicaliser, mais toute déradicalisation requiert un désengagement.
techniques d’intervention contre la radicalisation
construire un contre-discours
fournir une variété de repères
revivifier le sentiment d’appartenance à la communauté nationale
travailler l’empathie pour les victimes
faciliter l’intégration sociale et professionnelle