Chap 1 partie 2: Milieu INTERIEUR et Compartiments liquidiens
1/40
There's no tags or description
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced |
|---|
No study sessions yet.
41 Terms
Vasocontriction
Définition : c’est le resserrement (contraction) du diamètre des vaisseaux sanguins (surtout les artérioles).
Elle est provoquée par les muscles lisses de la paroi des vaisseaux qui se contractent.
📍 Conséquences :
Diminution du diamètre des vaisseaux → le sang circule dans un espace plus étroit.
Augmentation de la pression artérielle (comme quand on serre un tuyau d’arrosage).
Redistribution du sang vers les organes vitaux (cœur, cerveau) en cas de déshydratation ou d’hémorragie.
📌 Exemple hormonal :
Angiotensine II est l’une des hormones principales qui provoque la vasoconstriction → ça aide à maintenir la tension artérielle quand le volume sanguin est bas (déshydratation, perte de sang).
AVP (arginine-vasopressine, ou ADH)
👉 Rôle principal : Retenir l’eau au niveau des reins (urines plus concentrées).
= Limite la perte d’eau.
Elle est sécrétée par la neurohypophyse.
ANG II (angiotensine II)
👉Rôle principal :
Provoque la vasoconstriction (augmente la pression artérielle).
Stimule la soif.
= Maintient la pression et pousse à boire.
ANG II est une hormone “fonctionnelle” produite à partir d’une cascade enzymatique, et non directement sécrétée par une glande. (ce n’est pas une vraie hormone)
ALD (aldostérone)
👉 Rôle principal : Retenir le sodium (Na⁺) dans les reins (et donc l’eau suit).
= Augmente le volume sanguin.
Elle est sécrétée par les glandes surrénales
ANP (peptide atrial natriurétique)
👉 Rôle principal : Favoriser l’élimination de sodium et d’eau par les reins.
= Réduit le volume sanguin et baisse la pression.
c’est une hormone produite par les cellules des oreillettes du cœur.
Le liquide interstitiel
C'est le liquide qui baigne les cellules. Il se trouve dans les espaces entre les cellules.
Le plasma
C'est la partie liquide du sang, dans laquelle sont en suspension les cellules sanguines.
la lymphe
C'est un liquide clair qui circule dans le système lymphatique et aide à transporter les déchets et les nutriments.
Le liquide transcellulaire
Il s'agit de liquides spécifiques qui sont sécrétés par des cellules et se trouvent dans des cavités du corps. Le schéma en donne plusieurs exemples :
LCR (liquide céphalo-rachidien) : autour du cerveau et de la moelle épinière.
Liquide synovial : dans les articulations.
Liquide péritonéal : dans la cavité abdominale.
Liquide péricardique : autour du cœur.
Liquide oculaire : dans les yeux.
Liquide pleural : autour des poumons.
Le liquide intracellulaire (ICF)
le liquide qui se trouve à l'intérieur des cellules. Il représente 2/3 du TBW. Pour un adulte de 70 kg, cela correspond à environ 28 litres.
Le liquide extracellulaire (ECF)
le liquide qui se trouve à l'extérieur des cellules. Il représente 1/3 du TBW. Pour un adulte de 70 kg, cela correspond à environ 14 litres.
Les compartiments liquidiens du corps humain
poids corporel chez l'homme et 50% chez la femme.
Deux grands compartiments :
Liquide intracellulaire (LIC) : Le liquide à l'intérieur des cellules. C'est le plus grand compartiment, représentant environ 2/3 du volume total. Il est riche en potassium (K+).
Liquide extracellulaire (LEC) : Le liquide à l'extérieur des cellules, représentant environ 1/3 du volume total. Il est riche en sodium (Na+) et est divisé en deux sous-catégories principales :
Liquide interstitiel : Le liquide qui baigne les cellules.
Plasma : La partie liquide du sang.
En bref, l'eau est majoritairement à l'intérieur des cellules (LIC), le reste est à l'extérieur (LEC). La composition chimique de ces deux compartiments est très différente, mais leur concentration totale (osmolarité) est quasiment identique.
osmose
L’osmose est le déplacement de l’eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en solutés (dilué, hypotonique) vers le milieu le plus concentré en solutés (concentré, hypertonique), afin d’équilibrer les concentrations de part et d’autre de la membrane.
👉 En résumé :
Ce qui bouge = l’eau (et non les solutés).
Sens du mouvement = vers l’endroit le plus concentré en solutés.
But = rétablir un équilibre de concentration (homéostasie).
insensible skin
👉 Perte insensible en eau (perspiration insensible) :
C’est l’évaporation continue et inconsciente de l’eau présente dans la couche cornée et à la surface de la peau.
Elle est indépendante des glandes sudoripares (≠ sueur).
L’eau passe directement de l’état liquide (dans la peau) à l’état de vapeur (dans l’air).
Elle est favorisée par : température de l’air, mouvement de l’air (convection), humidité, etc.
👉 Perte de chaleur (thermorégulation) :
Elle se fait par rayonnement infrarouge, convection et conduction.
Le rayonnement ne transporte que de la chaleur (ondes infrarouges), pas d’eau.
Ce sont deux mécanismes distincts : l’un concerne l’eau (perte insensible), l’autre l’énergie thermique (rayonnement).
🔑 Donc :
La perte insensible en eau = évaporation d’eau.
La perte de chaleur par rayonnement = perte d’énergie thermique, mais pas d’eau.
🔹 Cas du brûlé du 3ᵉ degré
Dans une brûlure du 3ᵉ degré, toutes les couches de la peau sont détruites :
l’épiderme
le derme
parfois même l’hypoderme.
Comme les glandes sudoripares se trouvent dans le derme, elles sont elles aussi détruites.
👉 Donc le brûlé ne peut plus transpirer.
🔹 Pertes en eau
Normalement, on perd ~350–400 mL/jour d’eau insensible par simple évaporation à travers la couche cornée.
Chez le brûlé du 3ᵉ degré, la couche cornée protectrice n’existe plus.
Résultat : l’évaporation cutanée devient massive, bien au-delà des 350 mL habituels.
C’est pourquoi ces patients doivent être réhydratés intensivement avec du sérum physiologique et protégés par des pansements humides.
👉 Ce phénomène a permis de mettre en évidence que l’on peut perdre énormément d’eau sans sueur, uniquement par évaporation insensible.
🔹 Pertes en chaleur
En plus de l’eau, le brûlé perd énormément de chaleur.
Les vaisseaux sanguins mis à nu transportent du sang artériel à 37 °C, alors que l’air ambiant est beaucoup plus froid (ex. 23 °C).
Ce gradient thermique entraîne une perte massive de chaleur par rayonnement infrarouge et par convection.
saturation de l’air inspiré
Dans l’air ambiant, la pression totale = 760 mmHg (au niveau de la mer).
Cette pression est la somme des pressions partielles des gaz :
Azote (N₂)
Oxygène (O₂)
Dioxyde de carbone (CO₂)
Et un peu de vapeur d’eau.
Quand on inspire :
L’air qui arrive dans les voies respiratoires est réchauffé et humidifié.
Il est donc saturé en vapeur d’eau.
La pression de saturation de la vapeur d’eau à 37 °C = 47 mmHg.
🔹Conséquence :
La pression totale dans les poumons reste toujours 760 mmHg (elle ne change pas).
Mais une partie de cette pression est maintenant occupée par la vapeur d’eau (47 mmHg).
Donc, la place restante pour les autres gaz (O₂, N₂, CO₂) devient :
760 – 47 = 713 mmHg.
✅ En résumé :
L’air inspiré devient saturé en eau dans nos poumons.
Cette eau exerce une pression de 47 mmHg.
La pression totale reste 760 mmHg, donc les autres gaz ont moins de place.
Cette humidification correspond aux pertes insensibles pulmonaires (on perd de l’eau par la respiration).
tachycardie et tachypnée
Tachycardie : augmentation anormale de la fréquence cardiaque au-dessus des valeurs normales pour l’âge et l’état physiologique de la personne. Chez l’adulte au repos, elle est généralement définie comme une fréquence cardiaque > 100 battements par minute.
Tachypnée : augmentation anormale de la fréquence respiratoire au-dessus des valeurs normales. Chez l’adulte au repos, elle correspond généralement à plus de 20 respirations par minute.
Intoxication par l’eau après déshydratation
Après une déshydratation, le sang devient hypertonique, c’est-à-dire qu’il contient beaucoup de solutés comme le sodium, le calcium et le magnésium. Si on boit une grande quantité d’eau d’un coup, cette eau est hypotonique par rapport au sang, car elle contient très peu de solutés.
À cause de l’osmose, l’eau passe rapidement du sang vers les cellules pour équilibrer la concentration en solutés. Les cellules absorbent alors trop d’eau, gonflent et peuvent même éclater.
Conclusion : il faut boire de l’eau progressivement après une déshydratation pour éviter ce phénomène dangereux. (Ex : dans les marathons comme le tour de France en vélo il y a des accompagnateurs qui donne de l’eau au concourant durant la course. Cette eau est enrichie en soluté pour éviter les chocs osmotiques. )
Un anticholinergique
une substance ou un médicament qui bloque l’action de l’acétylcholine, un neurotransmetteur du système nerveux.
Rôle de l’acétylcholine : elle transmet les messages entre les neurones et entre les neurones et les muscles, et elle intervient aussi dans le fonctionnement de certains organes (cœur, intestins, glandes).
Effet des anticholinergiques : en bloquant l’acétylcholine, ils diminuent les contractions musculaires involontaires, réduisent les sécrétions (salive, sueur, mucus), et peuvent ralentir certaines fonctions digestives et urinaires.
Parathormone (PTH)
hormone sécrétée par les glandes parathyroïdes dont le rôle principal est de réguler la concentration de calcium dans le sang en agissant sur les os, les reins et l’intestin.
Chez un adulte en bonne santé, l’eau représente environ :
-60% du poids corporel total chez un homme
-50% du poids corporel total chez une femme
Remarque : cette différence de 10% est due à la masse musculaire.
1 mEq/L
1 millimole de charge électrique par litre de solution.
Cela prend en compte: • La quantité de substance (en millimoles) • La valence (charge) de l’ion.
Exemple : Na⁺ a une valence de 1, Ca²⁺ a une valence de 2.
Formule : mEq/L= mmol/L x valence
Exemple de calcul: Pour calcium (Ca²⁺) à 2 mmol/L:
mEq/L= qtte en mmol/L x valence mEq/L= 2 x 2 = 4 mEq/L
équilibre hydrique
Le volume total d’eau dans le corps reste globalement constant car l’organisme régule les entrées et les sorties.
Entrées d’eau : boissons, aliments, eau métabolique (provenant des réactions chimiques dans le corps).
Sorties d’eau : urines, transpiration, respiration, selles.
Chaque jour, l’eau du corps est constamment renouvelée, mais comme la quantité qui entre ≈ qui sort, le volume total reste stable.
osmolarité
la concentration totale de solutés dissous dans un litre d’eau qui exercent un effet osmotique (capables d’attirer ou de retenir l’eau).
En pratique, on mesure souvent l’osmolarité du plasma sanguin, exprimée en mOsm/L.
Exemple : le plasma a environ 285–295 mOsm/L, correspondant à l’ensemble des solutés osmotiquement actifs (sodium, glucose, urée, etc.).
Importance d’avoir la même pression osmotique :
Éviter l’éclatement/ rétrécissement des cellules
Les liquides ne passent pas d’un compartiment a un autre
Explication des mouvements osmotiques :
L’eau passe du milieu hypotonique ( =osmolarité faible, ou il y a trop d’eau et moins de soluté) a hypertonique (l’inverse)
OR : avec une osmolarité égale, je garantit que l’eau ne sort ni des capillaires vers l’interstitium (ou l’inverse), ni rentre/ sort de la cellule
posologie
c’est la manière dont un médicament doit être administré, incluant :
la dose (quantité à prendre),
la fréquence (combien de fois par jour),
la durée du traitement.
Mesure du liquide corporel total (LCT) :
On injecte une quantité connue d’un indicateur : eau tritiée (^3H₂O), eau lourde (^2H₂O) ou antipyrine (anti-inflammatoire).
L’indicateur se répartit dans tout le liquide corporel (attente 2‑3 h).
On prélève du sang et mesure la concentration de l’indicateur.
Le volume du LCT se calculesuivant la formule (dilution)
Mesure du liquide extracellulaire
J’utilise des anions ou des cations uniquement présents en extracellulaire uniquement en s’assurant que ces indicateurs sont incapables de passer en intracellulaire.
Ex : Na radioactif ou Cl radioactifs etc.
_Mais ici je ne peux pas distinguer entre le liquide plasmatique et interstitiel (j’ai tout le liquide extracellulaire).
Mesure du liquide intracellulaire
Je l’obtiens par déduction :
Liquide intracellulaire = liquide corps total – liquide extracellulaire
Mesure du volume plasmatique
Indicateurs utilisés :
Albumine
Bleu Evans (T-1824)
Principe :
Ces indicateurs sont de grosses molécules et restent dans les vaisseaux sanguins, car ils ne traversent pas les capillaires.
Le bleu Evans peut révéler une inflammation s’il traverse les capillaires.
calcul : image
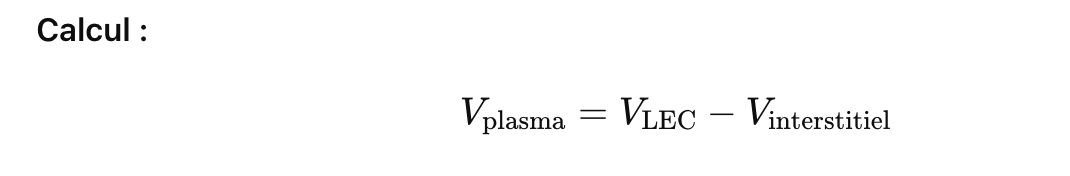
cation le plus abondant du milieu intracellulaire
Le sodium est le cation le plus abondant du milieu extracellulaire
avec une concentration de 140mEq/L. Il est présent dans le milieu
intracellulaire mais en plus petite quantité.
le magnésium
il est présent en faible quantité dans l’organisme, mais davantage dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire. Il joue un rôle essentiel comme cofacteur enzymatique dans de nombreuses réactions métaboliques et intervient dans le relâchement musculaire. Sous forme de magnésium tréonate, il peut traverser la barrière hémato-encéphalique et ainsi favoriser le sommeil.
le chlore
il se trouve beaucoup plus dans le milieu extracellulaire que
dans le milieu intracellulaire.
les phosphates et les anions organiques
sont beaucoup plus présentà l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les bicarbonate HCO3-
se trouvent plus dans le milieu extracellulaire.
C'est un ion important puisqu'on va s'en servir pour tamponner le pH,
maintenir un pH sanguin, neutre.
protéines
sont plus présentes dans le milieu intracellulaire que
dans le milieu extracellulaire.
Substance osmotiquement active
Une substance osmotiquement active est un soluté qui attire l’eau et provoque son déplacement à travers une membrane semi-perméable.
👉 Exemple : le Na⁺ reste surtout dans le compartiment extracellulaire et attire l’eau vers l’extérieur de la cellule.
Eau tritiée et volume d’eau totale
L’eau tritiée (eau marquée avec du tritium, isotope radioactif de l’hydrogène) est utilisée pour mesurer le volume d’eau totale de l’organisme, car elle se répartit uniformément dans tous les compartiments aqueux (intracellulaire + extracellulaire).
👉 Exemple : après injection d’eau tritiée, sa dilution permet de calculer la quantité totale d’eau dans le corps.
Indicateurs du liquide extracellulaire
Pour mesurer le volume du liquide extracellulaire (LEC), on utilise des indicateurs qui :
ne traversent pas la membrane cellulaire, donc restent en dehors des cellules,
peuvent diffuser à travers les capillaires pour se répartir dans tout l’espace extracellulaire.
👉 Exemples : sodium radioactif, iothalamate radioactif, thiosulfate, inuline.
Après injection et dilution de ces substances, on obtient la mesure du volume extracellulaire.
Volume du liquide intracellulaire
Le volume du liquide intracellulaire (VLIC) est plus difficile à mesurer directement, car il n’existe pas d’indicateur capable de traverser uniquement la membrane cellulaire sans se répartir ailleurs.
👉 La méthode utilisée est donc indirecte :
VLIC=VLiquide corporel total−VLiquide extracellulaireV_{LIC} = V_{\text{Liquide corporel total}} - V_{\text{Liquide extracellulaire}}VLIC=VLiquide corporel total−VLiquide extracellulaire
VLCORP T (volume de liquide corporel total) est mesuré avec un traceur diffusible partout (ex. eau tritiée).
V LEC (volume du liquide extracellulaire) est mesuré avec un traceur qui ne pénètre pas dans les cellules (ex. inuline, sodium radioactif).
Pourquoi le liquide transcellulaire n’est pas pris en compte
Le liquide transcellulaire (ex. liquide cérébrospinal, liquide synovial, liquide pleural, liquide digestif) est très faible en volume par rapport aux autres compartiments :
Liquide intracellulaire (≈ 28 L)
Liquide extracellulaire (≈ 14 L)
Liquide transcellulaire (≈ 1 L)
Sa contribution est donc négligeable dans le calcul global des volumes corporels.
👉 Ainsi, lorsqu’on calcule :
Vinterstitiel=Vextracellulaire−VplasmatiqueV_{\text{interstitiel}} = V_{\text{extracellulaire}} - V_{\text{plasmatique}}Vinterstitiel=Vextracellulaire−Vplasmatique
on ignore le liquide transcellulaire, car il n’influence pas significativement le résultat.